PLACEZ VOS PRODUITS ICI
CONTACTEZ [email protected]

Résumé
Cet article analyse les instruments juridiques dont dispose un État pour justifier la résiliation d’un contrat minier ou d’un titre d’exploitation devant les juridictions arbitrales internationales et pour engager, dans la même instance, des actions reconventionnelles à l’encontre des entreprises poursuivantes. L’étude s’appuie sur la pratique contentieuse des tribunaux CIRDI, CNUDCI et CPA pour démontrer que les mesures de retrait, suspension ou révocation adoptées à la suite de manquements contractuels, d‘atteintes environnementales, de défaillances fiscales, de retards d’investissement ou d’irrégularités dans l’obtention du titre relèvent de l’exercice légitime de l’autorité publique. Les décisions Methanex, Chemtura, World Duty Free, Metal-Tech, BSG Resources, Burlington, Perenco et Urbaser attestent que les tribunaux écartent les prétentions indemnitaires des investisseurs lorsque les faits établissent une conduite incompatible avec les normes internationales de conformité ou avec les obligations essentielles du contrat[1–8]. L’article démontre que ces mêmes éléments factuels ouvrent la voie à des contre-actions souveraines recevables, notamment pour dommages environnementaux, préjudices institutionnels, pertes fiscales, manquements au contenu local, corruption ou enrichissement injustifié. En mobilisant ces outils, l’État n’est plus un défendeur passif mais un acteur procédural pleinement capable d’obtenir réparation pour les préjudices causés au domaine public, aux écosystèmes et aux communautés locales. L’étude applique ces principes au contexte guinéen afin de montrer que les décisions récentes de résiliation de titres dans le secteur minier s’inscrivent dans les standards opératoires du contentieux extractif international et fondent une stratégie articulée de défense et de contre-action souveraines.
Mots-clés : Contentieux minier international ; arbitrage CIRDI ; résiliation de licence minière ; bauxite ; manquements contractuels ; corruption ; pollution minière ; contre-prétentions étatiques ; responsabilité de l’investisseur ; Code minier guinéen ; prix de transfert ; dommages environnementaux ; conformité extractive ; pratiques arbitrales ; gouvernance des ressources naturelles.
Contexte Général
Les litiges relatifs à la résiliation ou à la révocation de titres miniers occupent une place croissante dans le contentieux international des investissements, en raison de la multiplication des différends opposant des États à des sociétés extractives qui contestent la légalité des mesures adoptées pour assurer la conformité contractuelle, protéger l’intégrité environnementale ou préserver les intérêts fondamentaux de la nation. Dans ce contexte, l’État n’apparaît plus comme un sujet passif soumis aux prétentions indemnitaires des investisseurs, mais comme un acteur doté de prérogatives substantielles lui permettant d’articuler une stratégie procédurale complète, alliant justification de ses décisions internes et engagement d’actions reconventionnelles visant à faire reconnaître la responsabilité de l’investisseur pour les violations qui ont motivé la résiliation.
L’évolution de la jurisprudence arbitrale récente rend cette transformation particulièrement manifeste. Les tribunaux internationaux ont affirmé à plusieurs reprises que les mesures de retrait ou de résiliation adoptées en raison de comportements incompatibles avec les obligations contractuelles essentielles, de pratiques de corruption, de manquements environnementaux graves ou d’irrégularités dans l’acquisition du titre relèvent du domaine légitime de l’autorité publique. Les sentences Methanex c. États-Unis et Chemtura c. Canada confirment la validité de mesures adoptées pour protéger l’environnement et la santé publique, sans reconnaissance d’aucune responsabilité internationale de l’État[1–2]. Les décisions World Duty Free c. Kenya et Metal-Tech c. Ouzbékistan établissent que la corruption dans l’obtention d’un contrat ou d’une concession entraîne l’exclusion pure et simple de la protection internationale de l’investissement[3–4]. L’affaire BSG Resources c. Guinée transpose cette logique au secteur minier en reconnaissant la légitimité de la révocation d’un titre obtenu en violation grave des exigences de probité et de transparence[5]. Dans l’ensemble de ces affaires, les tribunaux arbitrent en ce sens que l’État exerce normalement ses prérogatives régaliennes lorsqu’il met fin à des concessions entachées de manquements substantiels.
Parallèlement, la jurisprudence a consolidé la possibilité pour l’État d’introduire des contre-prétentions recevables dans les procédures engagées par les investisseurs. La décision Burlington c. Équateur admet des demandes reconventionnelles en réparation de dommages environnementaux, et la sentence Perenco c. Équateur, tant dans sa décision intérimaire que dans sa décision finale, confirme la compétence du tribunal pour condamner l’investisseur au paiement d’indemnités liées à la dégradation d’aires d’exploitation[6–7]. L’affaire Urbaser c. Argentine étend encore le champ des contre-prétentions en examinant des manquements allégués aux obligations de service public et aux droits fondamentaux, même si la demande de l’État est finalement rejetée sur le fond[8]. Ces décisions démontrent que, dans la pratique contentieuse, l’État dispose d’une voie procédurale effective pour agir en demande et obtenir réparation des préjudices causés au domaine public, à l’environnement ou aux communautés locales, au sein même des arbitrages où il est initialement attrait en qualité de défendeur.
L’analyse qui suit examine ces mécanismes à la lumière du contexte guinéen, marqué par des résiliations récents de titres miniers dans le secteur de la bauxite et par des contentieux initiés devant les juridictions arbitrales internationales par certaines entreprises visées par ces décisions. En mobilisant les enseignements des affaires Methanex, Chemtura, World Duty Free, Metal-Tech, BSG Resources, Burlington, Perenco et Urbaser[1–8], l’article montre que les mesures guinéennes de résiliation s’inscrivent dans les standards du contentieux extractif international et reposent sur des bases factuelles et juridiques permettant non seulement de neutraliser les prétentions indemnitaires des investisseurs, mais également de fonder des contre-actions recevables pour obtenir la réparation des préjudices causés au domaine public, aux finances publiques et aux écosystèmes. L’étude articule cette démonstration en analysant d’abord les fondements juridiques de l’autorité unilatérale de l’État en matière de résiliation de titres miniers, puis les instruments permettant d’engager des contre-prétentions dans le cadre d’un arbitrage initié par les entreprises concernées, avant d’appliquer cette architecture aux résiliations récemment intervenues en Guinée.

I. Fondements juridiques de l’autorité unilatérale de l’État en matière de résiliation de titres miniers
L’exercice par l’État de ses prérogatives unilatérales dans le secteur extractif découle d’un ensemble cohérent de principes du droit international public, du droit interne minier et de la jurisprudence arbitrale contemporaine. La souveraineté permanente sur les ressources naturelles, consacrée dès la Résolution 1803 de l’Assemblée générale des Nations Unies, constitue le socle normatif à partir duquel les États définissent librement les modalités d’octroi, de renouvellement, de suspension ou de résiliation des titres miniers[9]. Ce principe, aujourd’hui considéré comme une norme coutumière à portée erga omnes, attribue à l’État une compétence exclusive pour organiser l’exploitation de ses ressources naturelles et préserver l’intégrité économique et environnementale de son territoire.
Les tribunaux arbitraux reconnaissent que la souveraineté sur les ressources naturelles confère à l’État un pouvoir intrinsèque de contrôle sur les concessions minières, indépendamment de toute qualification contractuelle. L’affaire Texaco c. Libye admet que l’État peut modifier, réviser ou révoquer un régime minier lorsque la préservation de l’intérêt public l’exige[10]. La jurisprudence Amoco International Finance Corp. c. Iran confirme que les titres d’exploitation reposent sur une expectative réglementaire et non sur une garantie de stabilité absolue[11]. Cette approche se retrouve plus récemment dans l’arbitrage BSG Resources c. Guinée, où le tribunal constate que la révocation d’un titre minier entaché d’irrégularités substantielles s’inscrit dans l’exercice normal des prérogatives régaliennes de l’État et ne constitue ni une expropriation ni une violation des standards internationaux lorsque la décision repose sur des éléments probatoires sérieux[5].
À l’intérieur de l’ordre juridique guinéen, le Code minier renforce cette architecture souveraine en érigeant le respect des obligations contractuelles, des normes environnementales et des engagements de transformation locale en conditions essentielles de maintien du titre. L’article 146 du Code minier guinéen (2011, révisé 2013) prévoit la résiliation de plein droit en cas de non-respect des engagements substantiels liés à la production, au contenu local, à la protection de l’environnement ou au paiement des redevances. La faculté de résiliation est d’autant plus légitime que le secteur minier guinéen a été marqué par des manquements graves relatifs aux engagements de transformation locale, aux obligations de remise en état et aux déclarations de production, qui constituent des violations caractérisées des conditions essentielles du titre.
La jurisprudence arbitrale récente renforce ce cadre interne en confirmant que les États disposent d’un pouvoir unilatéral de police visant à protéger l’environnement, la santé publique, la probité contractuelle et l’intégrité des ressources, sans que l’exercice de ce pouvoir ne puisse être qualifié d’expropriation illicite. Les affaires Methanex c. États-Unis et Chemtura c. Canada établissent que les mesures adoptées pour protéger l’intérêt public bénéficient d’une présomption de légalité dès lors qu’elles reposent sur des éléments scientifiques ou des constats administratifs avérés[1–2]. La sentence Tecmed c. Mexique rappelle que toute analyse d’expropriation doit tenir compte du caractère légitime et proportionné de l’objectif poursuivi par l’État[12]. Dans le contexte minier, l’affaire Copper Mesa Mining c. Équateur illustre que l’État peut légalement retirer un titre lorsque les activités minières créent des tensions sociales graves ou des risques pour la sécurité publique[13].
L’ensemble de ces normes démontre que la résiliation d’un titre minier ne constitue pas une ingérence arbitraire, mais l’exercice d’un pouvoir souverain encadré par le droit international et interne. Ce pouvoir est d’autant plus affirmé lorsque la résiliation repose sur des faits objectifs et sur des manquements caractérisés de l’investisseur, comme l’ont confirmé les tribunaux dans les affaires World Duty Free, Metal-Tech et BSG Resources[3–5]. L’État agit alors non en cocontractant, mais en autorité publique assurant la régularité de l’exploitation, la préservation du domaine public et la protection des intérêts fondamentaux de la nation, conformément à la hiérarchie des normes et à l’économie générale du droit minier international.
II. La reconnaissance arbitrale de la résiliation légitime fondée sur les manquements graves de l’investisseur
La résiliation d’un titre minier repose juridiquement sur la constatation objective de violations substantielles des obligations qui constituent la condition même de l’octroi de la concession. Les tribunaux arbitraux internationaux ont établi de manière constante que les manquements contractuels graves, les irrégularités dans l’acquisition du titre, les infractions environnementales ou les entorses aux engagements de développement local retirent à l’investisseur toute prétention à la protection internationale de l’investissement. Dans ces cas, la résiliation opérée par l’État ne constitue ni une expropriation ni un traitement arbitraire, mais l’exercice légitime d’un pouvoir régalien de contrôle.
 Screenshot
ScreenshotLa jurisprudence BSG Resources c. Guinée illustre ce principe avec une clarté paradigmatique. Le tribunal arbitral a considéré que la révocation des titres miniers du consortium résultait de manquements graves aux obligations de probité et de transparence dans l’obtention des blocs miniers, ainsi que d’irrégularités substantielles constatées par les autorités guinéennes[5]. En l’absence de bonne foi contractuelle, l’investisseur ne peut invoquer ni les clauses de stabilité ni les standards de traitement équitable. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la sentence World Duty Free c. Kenya, où la constatation d’un paiement de corruption a entraîné la perte totale de la protection internationale de l’investissement[3], et de l’affaire Metal-Tech c. Ouzbékistan, où le recours systématique à des intermédiaires pour faciliter l’acquisition de droits miniers a conduit à la même conclusion[4].
Les litiges relatifs aux manquements environnementaux suivent une logique similaire. Les affaires Burlington c. Équateur et Perenco c. Équateur ont démontré que les atteintes graves à l’environnement, l’absence de remise en état ou la dégradation des zones d’exploitation suffisent à justifier non seulement des mesures unilatérales de l’État, mais aussi l’admission de contre-prétentions permettant de rechercher la responsabilité financière de l’investisseur[6–7]. La sentence Burlington constitue à cet égard un précédent majeur : après avoir établi des violations graves des normes environnementales, le tribunal a rejeté les prétentions indemnitaires de l’investisseur et l’a condamné à verser une compensation substantielle à l’État équatorien. L’affaire Perenco a confirmé cette trajectoire en reconnaissant la compétence du tribunal pour juger la responsabilité environnementale directe de l’investisseur, indépendamment de la résiliation du contrat initial.
Les tribunaux acceptent également la légitimité des résiliations lorsqu’un investisseur viole des obligations essentielles relatives au développement local, à l’investissement minimal requis ou au respect du calendrier opérationnel. L’affaire Gold Reserve c. Venezuela montre que les retards inexpliqués dans la mise en valeur d’un projet extractif peuvent justifier l’intervention unilatérale de l’État lorsque les manquements affectent la bonne administration des ressources et compromettent les objectifs stratégiques du pays[15]. De même, dans l’affaire PSEG Global c. Turquie, le tribunal reconnaît que l’État peut intervenir pour mettre fin à un régime contractuel devenu incompatible avec l’intérêt public ou avec les exigences de bonne exécution de l’investissement[23].
La jurisprudence relative à la protection de l’environnement et des communautés confirme également que les risques sociaux ou écologiques induits par l’exploitation minière peuvent légitimement motiver la résiliation. Dans Copper Mesa Mining c. Équateur, le tribunal a constaté que les activités minières du demandeur avaient généré des conflits sociaux d’une intensité telle que la résiliation du titre constituait une réponse proportionnée à la protection de l’ordre public[13]. Ce raisonnement consolide la reconnaissance internationale du pouvoir souverain de l’État d’intervenir lorsque l’exploitation menace l’intégrité sociale ou sécuritaire du territoire.
Dans l’ensemble de ces affaires, les tribunaux établissent une ligne doctrinale solide : la résiliation est juridiquement fondée lorsque l’investisseur viole des obligations essentielles qui conditionnent la validité et la continuation du titre. Le droit international n’accorde aucune immunité à l’investisseur défaillant ; au contraire, il reconnaît la primauté de l’autorité réglementaire de l’État et l’exigence de probité, de diligence et de conformité environnementale dans l’exploitation des ressources naturelles. Cette jurisprudence fournit ainsi un cadre normatif précis pour apprécier la légalité des décisions guinéennes de résiliation, dès lors que celles-ci se fondent sur des faits établis, documentés et imputables aux opérateurs concernés.
III. Le pouvoir offensif de l’État : la recevabilité croissante des contre-prétentions dans l’arbitrage international
L’évolution récente de la jurisprudence arbitrale confirme que l’État n’est plus limité à une posture défensive dans les litiges initiés par les investisseurs. Les tribunaux reconnaissent désormais que l’État peut engager des contre-prétentions recevables dès lors que celles-ci se rattachent directement aux obligations légales ou contractuelles incombant à l’investisseur. Cette dynamique transforme profondément l’équilibre procédural traditionnel et ouvre à l’État la possibilité d’obtenir réparation des préjudices causés au domaine public, aux écosystèmes, aux finances nationales ou aux communautés locales par les opérateurs miniers défaillants.
 Screenshot
ScreenshotLe précédent fondateur de cette évolution se trouve dans la sentence Burlington c. Équateur, où le tribunal a admis la compétence pour examiner des contre-prétentions environnementales formulées par l’État à l’encontre de l’investisseur[6]. Après avoir constaté des violations graves relatives à la contamination des sols, à la dégradation des zones d’exploitation et à l’absence de mesures de remise en état, le tribunal a condamné l’investisseur à indemniser l’État. Cette décision a établi une règle doctrinale décisive : l’investisseur ne peut réclamer la protection internationale d’un investissement en même temps qu’il viole des obligations essentielles, et sa responsabilité peut être recherchée dans le cadre de la même procédure arbitrale.
La jurisprudence Perenco c. Équateur confirme et amplifie cette logique. Le tribunal a reconnu sa compétence pour évaluer la responsabilité environnementale directe de l’investisseur, indépendamment du différend initial portant sur la résiliation du contrat[7]. La décision finale impose à l’investisseur une obligation d’indemnisation substantielle, démontrant que les contre-prétentions de l’État constituent un mécanisme autonome de rétablissement de l’équilibre contractuel et de protection des intérêts publics. À travers ce précédent, la doctrine arbitrale consacre un principe fondamental : les investisseurs sont pleinement responsables devant les tribunaux internationaux des préjudices qu’ils causent au territoire d’accueil.
L’affaire Urbaser c. Argentine constitue un développement essentiel de cette évolution. Le tribunal, bien que rejetant les prétentions argentines sur le fond, reconnaît en principe la possibilité d’engager des contre-prétentions fondées sur des obligations positives de l’investisseur, notamment en matière de droits fondamentaux, de services publics et de continuité des obligations essentielles envers la population[8]. Cette reconnaissance élargit substantiellement l’espace juridique des contre-actions de l’État en affirmant que l’investisseur ne dispose pas d’une immunité structurelle à l’intérieur de l’arbitrage.
 Screenshot
ScreenshotLes implications de cette évolution jurisprudentielle pour la Guinée sont considérables. Lorsque l’État résilie un titre minier en raison de manquements graves, les mêmes éléments factuels qui justifient la résiliation peuvent fonder des contre-prétentions devant le tribunal arbitral. Les irrégularités dans l’obtention des titres, la défaillance dans la réalisation des investissements requis, le non-respect des normes environnementales, l’atteinte aux zones agricoles ou forestières, la dégradation des infrastructures et l’absence de transformation locale constituent des manquements susceptibles d’engager la responsabilité internationale de l’investisseur. Si l’entreprise entame une procédure arbitrale, l’État dispose d’une base solide pour engager une action reconventionnelle demandant réparation du préjudice environnemental, économique ou social résultant des violations contractuelles.
Les décisions World Duty Free et Metal-Tech, en établissant que les investissements obtenus par corruption ne bénéficient d’aucune protection internationale, renforcent encore la capacité offensive de l’État[3–4]. Dans de tels contextes, une contre-prétention fondée sur les préjudices causés à l’intégrité de l’administration publique, aux finances nationales ou à la réputation internationale du pays s’inscrit dans la logique des mécanismes déjà validés par la jurisprudence arbitrale.
Cette évolution doctrinale permet d’affirmer que l’arbitrage contemporain repose sur une dynamique d’équilibre et non sur une asymétrie structurelle en faveur de l’investisseur. L’État exerce désormais un pouvoir normatif et procédural affirmé, capable non seulement de défendre la légalité de ses décisions internes mais aussi de poursuivre l’investisseur pour les violations substantielles qui ont justifié la résiliation du titre. La contre-prétention n’est plus un mécanisme accessoire : elle constitue aujourd’hui un instrument central de la stratégie contentieuse des États, particulièrement dans les litiges miniers où les manquements de l’investisseur causent des dommages significatifs au domaine public et au tissu socio-économique.
IV. Application stratégique au contexte guinéen : articulation entre légalité interne, souveraineté internationale et actions offensives contre les investisseurs défaillants
L’évolution jurisprudentielle analysée plus haut confère à la République de Guinée un cadre juridique solide pour défendre la légalité de ses décisions de résiliation tout en engageant des contre-prétentions devant les mêmes tribunaux où les investisseurs tentent de contester ces mesures. La cohérence entre le droit interne minier guinéen, les normes internationales de souveraineté permanente sur les ressources naturelles et la jurisprudence arbitrale contemporaine permet à l’État de s’inscrire dans une stratégie intégrée, dans laquelle la résiliation n’apparaît plus comme une mesure litigieuse, mais comme la conséquence nécessaire de manquements contractuels graves imputables aux entreprises concernées.

La pratique administrative guinéenne a révélé, dans plusieurs dossiers récents, des obligations substantielles non respectées par certains opérateurs, notamment en matière de transformation locale, de conformité environnementale, de respect du calendrier d’investissement ou d’exactitude des déclarations de production. Le Code minier guinéen érige ces obligations en conditions essentielles du titre, et leur violation engage directement la faculté de résiliation sans indemnisation. Cette architecture interne est parfaitement compatible avec la jurisprudence arbitrale, qui considère que les obligations essentielles définies par la législation minière font partie de l’économie générale de la concession et conditionnent la protection internationale de l’investissement.
Lorsque l’investisseur initie une procédure arbitrale pour contester la résiliation d’un titre, l’État guinéen se trouve en mesure d’articuler une défense fondée sur trois éléments convergents. Le premier résulte de la démonstration factuelle et juridique des manquements commis par l’opérateur, conformément à la logique adoptée dans les affaires BSG Resources, Metal-Tech et World Duty Free[3–5]. La résiliation devient alors la conséquence directe de violations imputables à l’investisseur lui-même, excluant toute responsabilité internationale de l’État. Le second repose sur la qualification des mesures de résiliation en tant qu’acte de police légitime visant à préserver l’intégrité environnementale, la probité administrative ou la sécurité publique, conformément aux standards établis dans Methanex, Chemtura, Copper Mesa et Tecmed[1–2][12–13]. Le troisième permet de neutraliser les réclamations indemnitaires en démontrant l’absence de toute légitime expectative, notamment lorsque l’investisseur a violé les obligations essentielles ayant motivé l’octroi initial du titre.
La stratégie guinéenne ne se limite toutefois pas à cette posture défensive. Les mêmes éléments factuels qui fondent la résiliation peuvent être mobilisés pour engager des contre-prétentions recevables, conformément à la jurisprudence Burlington, Perenco et Urbaser[6–8]. Lorsqu’un investisseur a causé des préjudices environnementaux substantiels, omis d’exécuter des obligations de remise en état, manqué à ses engagements en matière de transformation locale, dégradé des infrastructures publiques, ou obtenu son titre dans un contexte marqué par des irrégularités administratives graves, l’État peut demander la réparation complète du dommage causé à son territoire et à ses finances publiques.
Dans les procédures ouvertes contre la Guinée dans le secteur de la bauxite, une telle stratégie offensive apparaît pleinement fondée. Les décisions administratives à l’origine des résiliations reposent sur des manquements documentés relatifs à l’absence d’unités de transformation locale, au retard substantiel dans la réalisation des investissements requis, à la non-conformité des plans de gestion environnementale ou à l’inexécution des obligations relatives au contenu local. Dans ce contexte, l’État est habilité à démontrer que les violations invoquées par les entreprises ne résultent pas d’une prétendue ingérence étatique, mais d’un défaut d’exécution imputable aux opérateurs eux-mêmes.
L’articulation de cette stratégie repose sur une mise en cohérence entre les obligations contractuelles, les constats administratifs et les standards internationaux. Les constats relatifs à la dégradation des sols, au non-respect des périmètres de sécurité, à l’absence d’équipements de mitigation environnementale, à l’insuffisance des compensations sociales ou au non-paiement de certaines redevances constituent des fondements objectifs pour des contre-actions, conformément aux principes posés dans Burlington et Perenco[6–7]. Lorsqu’un investisseur n’a pas satisfait à ces obligations essentielles, il ne peut invoquer la protection internationale de son investissement ; au contraire, il engage sa responsabilité directe devant le tribunal, et l’État est habilité à solliciter des dommages-intérêts proportionnés au préjudice subi.
Ainsi, dans le contexte guinéen, l’action contentieuse cesse d’être un exercice défensif et devient un levier normatif de protection du domaine public et de consolidation de la souveraineté économique. L’État valide la légalité de ses décisions internes, neutralise les réclamations indemnitaires infondées et obtient réparation des manquements substantiels des investisseurs. Cette dynamique place la Guinée dans la continuité des États qui, à l’instar de l’Équateur, du Canada ou du Mexique, ont affirmé avec succès leur capacité à défendre et à faire valoir leurs droits souverains devant les tribunaux internationaux, conformément aux principes du droit des investissements contemporains.
V. Conclusion générale : Vers une souveraineté contentieuse affirmée dans les litiges miniers internationaux
L’analyse conduite dans cet article démontre que la République de Guinée dispose d’un fondement juridique robuste pour défendre la légalité de ses résiliations dans le secteur minier tout en développant, de manière concertée, une stratégie offensive articulée autour de contre-prétentions systématiquement recevables devant les tribunaux arbitraux internationaux. Loin d’être un acteur passif soumis à la pression des investisseurs ou au fardeau procédural du contentieux arbitral, l’État se positionne comme une partie pleinement autonome et stratégiquement avisée, capable de mobiliser les standards internationaux du droit des investissements afin de consolider la protection de ses ressources naturelles et de ses intérêts économiques fondamentaux.
La convergence entre le droit interne minier guinéen, la souveraineté permanente sur les ressources naturelles consacrée par le droit international général, et les orientations jurisprudentielles contemporaines constitue le socle normatif de cette souveraineté contentieuse. Les tribunaux arbitraux reconnaissent désormais de manière explicite que les États sont fondés à adopter toutes mesures nécessaires pour préserver l’intégrité écologique, la probité administrative, la stabilité économique et la sécurité nationale, même lorsque ces mesures affectent des investissements étrangers. Les décisions Methanex, Chemtura, Copper Mesa ou encore Tecmed confirment que ces prérogatives régulatoires relèvent de l’essence même de la compétence souveraine, et qu’elles ne sauraient être assimilées à une expropriation illicite dès lors qu’elles sont fondées sur des éléments objectifs et proportionnés[1–2][12–13].
Cette affirmation du rôle régulatoire de l’État n’éclipse pas la possibilité d’action offensive. Au contraire, les précédents Burlington, Perenco et Urbaser démontrent que les contre-prétentions étatiques sont désormais pleinement intégrées dans le régime contentieux des investissements[6–8]. Lorsque l’investisseur a causé des dommages environnementaux, violé les normes sociales minimales, manqué à ses engagements contractuels ou obtenu son titre dans un contexte d’irrégularités administratives, l’État est en droit d’exiger réparation intégrale. La logique indemnitaire ne se limite plus à compenser l’investisseur ; elle peut désormais sanctionner celui-ci lorsque les violations sont établies.
Dans le contexte guinéen, cette possibilité prend une dimension structurante. Les litiges initiés dans le secteur de la bauxite et du fer doivent être compris comme l’occasion d’une réaffirmation juridique forte de la souveraineté nationale. La République de Guinée peut démontrer que ses résiliations reposent sur des manquements substantiels imputables aux opérateurs, en lien avec des obligations essentielles telles que la transformation locale, la conformité environnementale, le respect des calendriers d’investissement ou la transparence des déclarations de production. De surcroît, la responsabilité de ces opérateurs peut être engagée pour les préjudices causés au domaine public, à la population locale ou à l’environnement minier, ouvrant la voie à des condamnations financières substantielles.
La stratégie guinéenne doit ainsi reposer sur une articulation méthodique entre défense et attaque. La défense consiste à démontrer que la mesure litigieuse est pleinement légale, nécessaire à la protection du domaine public et conforme aux normes internationales. L’attaque consiste à engager la responsabilité de l’investisseur pour ses propres violations, à solliciter des dommages-intérêts proportionnés et à transformer le contentieux arbitral en levier de régulation économique. Cette double capacité, caractéristique des États exerçant une souveraineté mature, permet de neutraliser les risques financiers tout en renforçant la crédibilité institutionnelle du pays dans l’espace minier international.
L’État guinéen ne s’inscrit plus dans une posture réactive mais dans une dynamique proactive, structurée par une doctrine claire : toute entreprise étrangère exploitant les ressources nationales doit respecter scrupuleusement les obligations qui conditionnent son titre, et toute violation substantielle engage non seulement la possibilité de résiliation, mais également la responsabilité financière de l’investisseur. Cette approche, conforme aux standards internationaux les plus récents, inscrit la Guinée dans une tradition jurisprudentielle contemporaine, celle des États qui, à l’instar de l’Équateur, du Canada ou du Mexique, affirment pleinement la légalité de leurs actions et obtiennent réparation des manquements commis par les opérateurs privés.
L’enjeu dépasse la seule résolution des litiges en cours. Il s’agit d’affirmer, dans le champ du droit international économique, la capacité de la République de Guinée à défendre et faire valoir ses droits souverains, à protéger l’intégrité de son patrimoine minier et à consolider la légitimité de ses politiques publiques. Ce positionnement contribue à la construction d’un environnement normatif où l’investissement étranger demeure bienvenu, mais où la violation des obligations essentielles expose l’investisseur à des conséquences juridiques effectives. Cette dynamique renforce la crédibilité du pays, sécurise son cadre institutionnel et affirme la pleine effectivité du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles.
Adama Guilavogui, Ph.D., JD
Références
[1] Methanex Corporation v. United States of America, UNCITRAL, Final Award, 3 August 2005.
[2] Chemtura Corporation v. Government of Canada, UNCITRAL, Award, 2 August 2010.
[3] World Duty Free Company Ltd. v. Republic of Kenya, ICSID Case No. ARB/00/7, Award, 4 October 2006.
[4] Metal-Tech Ltd. v. Republic of Uzbekistan, ICSID Case No. ARB/10/3, Award, 4 October 2013.
[5] BSG Resources Limited v. Republic of Guinea, PCA Case No. 2015-39, Final Award, 14 May 2019.
[6] Burlington Resources Inc. v. Republic of Ecuador, ICSID Case No. ARB/08/5, Decision on Counterclaims, 7 February 2017.
[7] Perenco Ecuador Ltd. v. Republic of Ecuador, ICSID Case No. ARB/08/6, Interim Decision on Environmental Counterclaims, 11 August 2015 ; Final Award, 27 September 2021.
[8] Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/07/26, Award, 8 December 2016.
[9] Résolution 1803 (XVII), Assemblée générale des Nations Unies, « Souveraineté permanente sur les ressources naturelles », 14 décembre 1962.
[10] Texaco Overseas Petroleum Company and California Asiatic Oil Company v. The Government of the Libyan Arab Republic, Award, 19 January 1977.
[11] Amoco International Finance Corporation v. Iran, Iran–United States Claims Tribunal, Award No. 310-56-3, 14 July 1987.
[12] Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/00/2, Award, 29 May 2003.
[13] Copper Mesa Mining Corporation v. Republic of Ecuador, PCA Case No. 2012-2, Award, 15 March 2016.
[14] Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v. The Republic of Ecuador, ICSID Case No. ARB/06/11, Award, 5 October 2012.
[15] Gold Reserve Inc. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB(AF)/09/1, Award, 22 September 2014.
[16] Crystallex International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB(AF)/11/2, Award, 4 April 2016.
[17] Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El Salvador, ICSID Case No. ARB/09/12, Award, 14 October 2016.
[18] Parkerings-Compagniet AS v. Republic of Lithuania, ICSID Case No. ARB/05/8, Award, 11 September 2007.
[19] El Paso Energy International Company v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/15, Award, 31 October 2011.
[20] Phoenix Action, Ltd. v. The Czech Republic, ICSID Case No. ARB/06/5, Award, 15 April 2009.
[21] Waste Management, Inc. v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/00/3, Award, 30 April 2004.
[22] SGS Société Générale de Surveillance S.A. v. Republic of Paraguay, ICSID Case No. ARB/07/29, Award, 10 February 2012.
[23] PSEG Global Inc. and Konya Ilgin Elektrik Üretim ve Ticaret Limited Şirketi v. Republic of Turkey, ICSID Case No. ARB/02/5, Award, 19 January 2007.
L’article L’État face aux litiges miniers internationaux : résiliation, défense et contre-actions souveraines (Par Dr Adama Guilavogui) est apparu en premier sur Mediaguinee.com.
.png)
 il y a 1 mois
160
il y a 1 mois
160










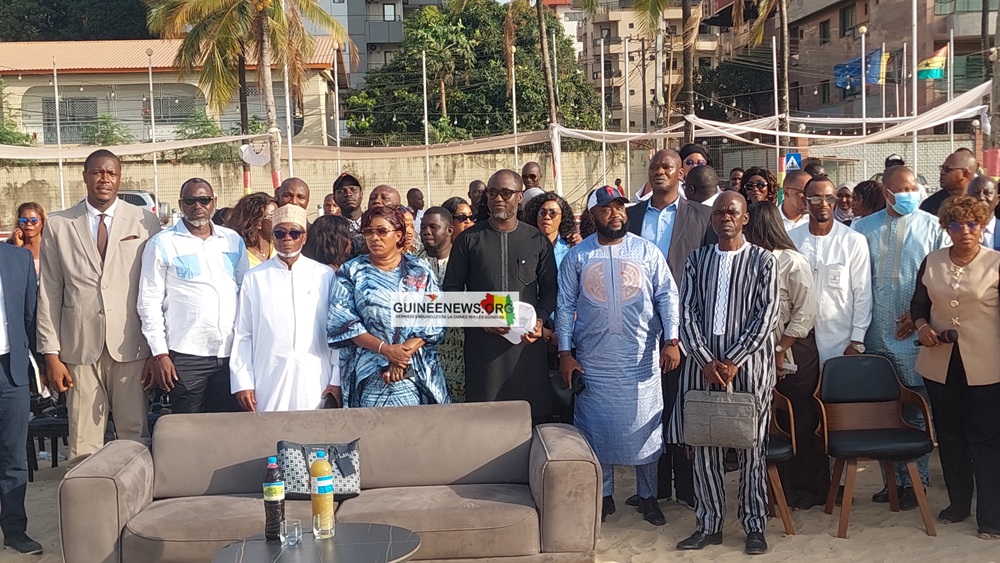







 English (US) ·
English (US) ·