PLACEZ VOS PRODUITS ICI
CONTACTEZ [email protected]
Depuis une vingtaine d’années, les journalistes d’investigation du monde entier se réunissent tous les deux ans dans un pays de leur choix pour discuter des enjeux, des défis et des meilleures pratiques du métier.
 Il s’agit d’une initiative du Réseau mondial pour le journalisme d’investigation (GIJN) qui réunit la communauté des journalistes. Cette année, la conférence s’est tenue à Kuala Lumpur, en Malaisie, du 20 au 24 novembre 2025.
Il s’agit d’une initiative du Réseau mondial pour le journalisme d’investigation (GIJN) qui réunit la communauté des journalistes. Cette année, la conférence s’est tenue à Kuala Lumpur, en Malaisie, du 20 au 24 novembre 2025.
Les sessions, animées par les meilleurs professionnels du secteur, ont porté sur les techniques d’investigation les plus récentes, l’analyse des données et la collaboration transfrontalière.
Parmi les panelistes, figure David Dembelé, président du Conseil d’administration de la Cellule Norbert Zongo pour le journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO).
 En exil à cause de ses reportages critiques sur le régime militaire dans son pays, le Mali, il a expliqué aux participants les stratégies que les journalistes exilés peuvent adopter pour travailler sur des sujets dans des pays où sévit la censure.
En exil à cause de ses reportages critiques sur le régime militaire dans son pays, le Mali, il a expliqué aux participants les stratégies que les journalistes exilés peuvent adopter pour travailler sur des sujets dans des pays où sévit la censure.
Le coordinateur de la CENOZO, Arnaud Ouédraogo, également présent à ce rendez-vous mondial, est intervenu sur la sécurité et la protection des journalistes, des lanceurs d’alerte et des sources lors d’enquêtes sensibles.
 « Nous avons évoqué les difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes d’Afrique de l’Ouest lorsqu’ils traitent des sujets sensibles, notamment en matière de sécurité. Cela inclut les menaces, les surveillances, les filatures et les campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux. Il s’agissait d’expliquer ces réalités à l’audience et de partager les solutions que nous proposons pour y faire face », a-t-il déclaré à l’issue de la conférence.
« Nous avons évoqué les difficultés auxquelles sont confrontés les journalistes d’Afrique de l’Ouest lorsqu’ils traitent des sujets sensibles, notamment en matière de sécurité. Cela inclut les menaces, les surveillances, les filatures et les campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux. Il s’agissait d’expliquer ces réalités à l’audience et de partager les solutions que nous proposons pour y faire face », a-t-il déclaré à l’issue de la conférence.
Selon lui, ces solutions passent nécessairement par des formations en sécurité physique et digitale pour les journalistes, ainsi que par un accompagnement juridique en cas de besoin.
« Enfin, nous les mettons en relation avec certains de nos partenaires qui peuvent les aider à échapper à des situations dangereuses, par exemple en quittant le pays lorsqu’ils sont réellement en danger », a-t-il expliqué.
Lors d’un autre panel, la CENOZO a partagé son modèle de collaboration transfrontalière. Le coordinateur a expliqué comment le réseau sous-régional met en place des équipes d’enquête dans différents pays, en prenant en compte les différences de langue, de juridiction et de culture.
« Nous avons insisté sur l’importance d’avoir une vision holistique du problème. Un même problème peut exister dans plusieurs pays : nous réunissons donc des journalistes qui posent la problématique de manière cohérente, identifient les mêmes types de sources et reconnaissent les nuances liées aux contextes juridiques et sécuritaires. Une fois ces risques évalués, nous proposons des solutions sur mesure pour chaque membre de l’équipe, selon son contexte. Chacun réalise un reportage local, qui sera ensuite combiné en une histoire globale et cohérente. », a-t-il précisé.
Pour la plupart des participants, la Conférence mondiale sur le journalisme d’investigation est le meilleur endroit pour créer des connexions et développer des projets d’envergure.
Madeleine N’Geunga, journaliste d’investigation basée au Cameroun qui travaille pour le Pulitzer Center en tant qu’éditrice pour l’Afrique, fait partie de ces femmes journalistes d’investigation qui ont participé à cette conférence mondiale. Elle se réjouit des nombreuses opportunités qu’offre cette conférence.
 « L’autre opportunité que nous offre la Global Investigative Journalism Conference, c’est surtout de réfléchir ensemble à la manière dont nous pouvons rester résilients dans notre travail, de réfléchir à la façon dont nous pouvons développer de nouvelles stratégies pour travailler sur des sujets qui nous sont communs, et à comment partager nos expériences pour améliorer ce que nous faisons déjà. Ce que j’aime beaucoup ici, c’est qu’autour d’une conversation avec un journaliste qu’on n’a jamais rencontré, on trouve une affinité et de là naît un projet, et du projet peuvent découler plusieurs autres choses. À la fin, cela devient une communauté de soutien que nous bâtissons doucement, lentement, mais une communauté qui est très forte et qui nous soutient pendant plusieurs années. », s’est-elle réjouie.
« L’autre opportunité que nous offre la Global Investigative Journalism Conference, c’est surtout de réfléchir ensemble à la manière dont nous pouvons rester résilients dans notre travail, de réfléchir à la façon dont nous pouvons développer de nouvelles stratégies pour travailler sur des sujets qui nous sont communs, et à comment partager nos expériences pour améliorer ce que nous faisons déjà. Ce que j’aime beaucoup ici, c’est qu’autour d’une conversation avec un journaliste qu’on n’a jamais rencontré, on trouve une affinité et de là naît un projet, et du projet peuvent découler plusieurs autres choses. À la fin, cela devient une communauté de soutien que nous bâtissons doucement, lentement, mais une communauté qui est très forte et qui nous soutient pendant plusieurs années. », s’est-elle réjouie.
La conférence a permis à plus de 1 500 participants venus de 135 pays de bénéficier de plus de 150 sessions, notamment des panels, des ateliers et des rencontres de réseautage.
Au-delà des nombreuses sessions, ce rendez-vous mondial des journalistes d’investigation a été l’occasion pour les professionnels présents de rendre hommage à leurs confrères emprisonnés, tués dans l’exercice de leur métier ou portés disparus.
Les milliers de participants ont insisté sur le fait que « le journalisme n’est pas un crime ».
Hadja Kadé BARRY
.png)
 il y a 1 mois
188
il y a 1 mois
188











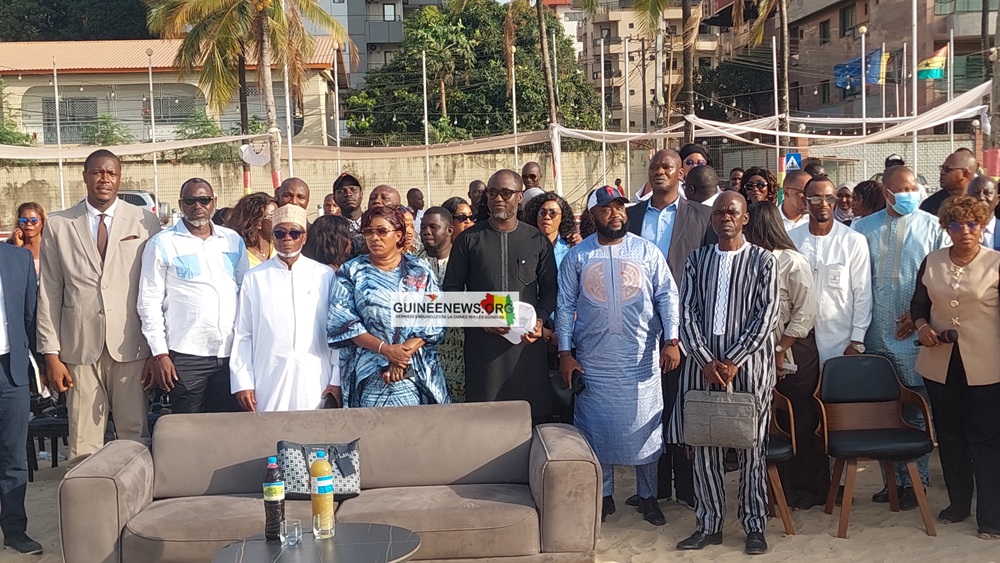







 English (US) ·
English (US) ·