PLACEZ VOS PRODUITS ICI
CONTACTEZ [email protected]
Les pactes internationaux relatifs aux droits civiques et politiques renforcent les instruments internationaux de protection des droits de l’homme. Adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966, les Pactes internationaux relatifs aux droits civiques (PICP) et aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) instituent un régime conventionnel contraignant de protection des droits de l’homme, contrairement à la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), qui a été adoptée sous forme de déclaration et est donc dépourvue de toute force contraignante pour les États. Il est vrai que la DUDH est considérée aujourd’hui comme un instrument juridique ayant force de coutume, mais son opposabilité aux États demeure une problématique de volonté politique et d’approche culturelle. Cette classification des pactes de 1966 opère une subdivision des types de droits en plusieurs générations.
Les droits civils et politiques, appelés « droits-libertés », tels que le droit à la vie, à la liberté d’expression, à la liberté religieuse et au droit de ne pas être arbitrairement arrêté ou détenu, s’opposent aux droits économiques, sociaux et culturels, appelés « droits créances », tels que le droit à la santé, au logement, à la sécurité sociale, à l’alimentation et à l’éducation, sur plusieurs points.
Les premiers droits, « droits civils et politiques », exigent de l’État une abstention : l’individu ne doit pas être entravé dans la jouissance de ces libertés individuelles. Les seconds, « droits créances », supposent une intervention active de l’État : la construction d’écoles, d’hôpitaux, de routes, de chemins de fer, etc.
Dans leur philosophie, les droits civils et politiques sont des droits à tonalité libérale, garantissant à l’individu une autonomie intellectuelle et juridique, tandis que les droits créances ont une coloration sociale et poursuivent l’objectif de réduire les inégalités d’ordre économique dans une perspective de justice sociale.
Ces droits sont distincts en ce que les droits-libertés sont considérés par la doctrine comme de « vrais droits de l’homme », dont le titulaire est identifiable et dont la protection peut être garantie en justice. Les droits créances, en revanche, promettent la garantie d’un idéal, d’une société juste ; c’est pourquoi leur titulaire peine à en obtenir la protection judiciaire.
En effet, si le juge peut protéger la liberté d’expression ou le droit à la vie privée, il ne saurait accorder un logement ou procurer un emploi.
La distinction entre droits-libertés et droits créances a été critiquée. Il existe en effet des cas où la réalisation ou la protection des droits civils et politiques exige de l’État une action. Comment garantir le droit de vote sans mettre en place des mécanismes de consultation électorale, des bureaux de vote, etc. ? Comment garantir l’accès à la justice et à un procès équitable sans une organisation judiciaire ? De sorte que beaucoup de ces droits ont une double dimension, civile et sociale.
La distinction entre droits-libertés et droits créances semble dépassée en droit international des droits de l’homme. De nos jours, les États signataires de ces conventions internationales relatives aux droits de l’homme ont une triple obligation : respecter, protéger et réaliser les droits.
L’obligation de respecter induit une obligation négative : l’État doit respecter les droits, mais aussi une obligation positive : l’État doit protéger les bénéficiaires de ces droits contre toute violation perpétrée par des tiers, notamment grâce à l’édiction d’une législation protectrice et à l’instauration de recours juridictionnels adéquats.
Il faut ensuite évoquer l’obligation de réaliser les droits, qui correspond à une obligation d’intervention de l’État. Il s’agit d’une obligation valable aussi bien pour les droits sociaux et culturels que pour les droits civils et politiques.
La jurisprudence de la CEDH considère que « pour qu’un État puisse invoquer le manque de ressources lorsqu’il ne s’acquitte pas de ses obligations fondamentales minimales, il doit démontrer qu’aucun effort n’a été épargné pour utiliser toutes les ressources qui sont à sa disposition en vue de remplir, à titre prioritaire, ces obligations minimales ».
En définitive, la distinction entre droits-libertés et droits créances mérite d’être fortement atténuée, si ce n’est abandonnée. Tous les droits de l’homme, quels qu’ils soient, génèrent à la fois des obligations positives et négatives à la charge des pouvoirs publics.
Alpha Oumar Camara
.png)
 il y a 11 mois
239
il y a 11 mois
239















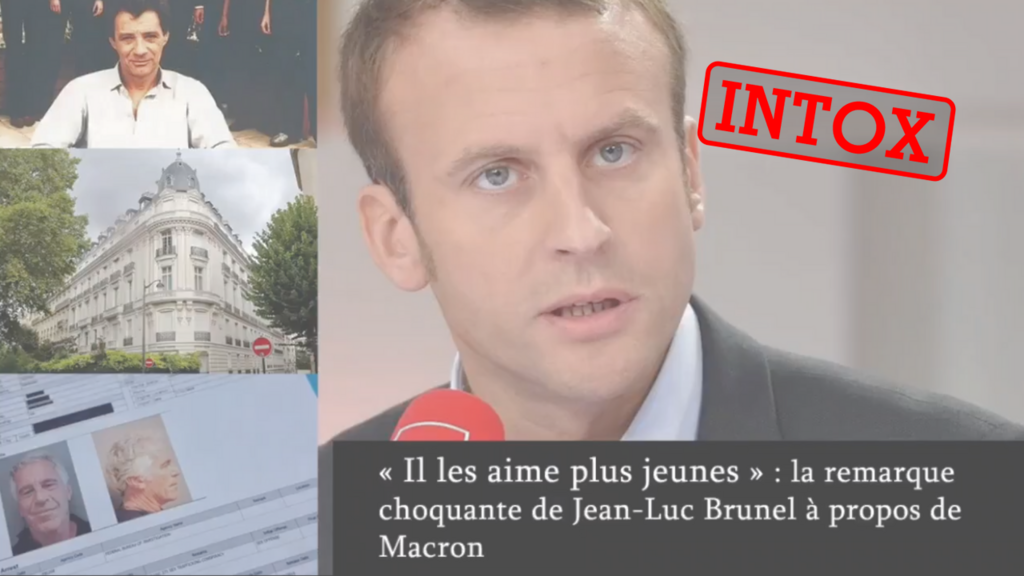


 English (US) ·
English (US) ·