PLACEZ VOS PRODUITS ICI
CONTACTEZ [email protected]

Guo Qinghua
Combien y a-t-il d’arbres en Chine ? Dans le passé, personne ne pouvait donner une réponse définitive. Aujourd’hui, la réponse réside dans la première « carte de densité des arbres » de Chine publiée cette année : en 2020, le pays comptait environ 142,6 milliards d’arbres, soit l’équivalent d’environ 100 arbres par personne sur une population de plus de 1,4 milliard d’habitants. Ces chiffres ont été minutieusement comptés par mon équipe et moi au cours d’une décennie d’efforts dévoués.
Pourquoi compter les arbres de Chine ? Cela commence par des réalités urgentes. La Chine possède la plus grande superficie de forêts artificielles, mais les statistiques passées sur les ressources forestières se sont principalement concentrées sur des mesures au niveau macro comme le volume de bois. Depuis la nouvelle ère, où le développement vert fait consensus et où les objectifs du « double carbone » sont proposés, notre compréhension des forêts ne peut plus se limiter à de vagues ébauches. Au lieu de cela, nous avons besoin d’un « registre vert » plus précis qui prenne en compte le stockage de carbone au niveau de chaque arbre, la capacité de soutien de la biodiversité et d’autres facteurs. Le boisement doit donner la priorité à la plantation d’arbres là où cela est approprié, d’arbustes là où cela est approprié et de graminées là où c’est approprié. Ce n’est qu’avec des données précises que nous pouvons prendre des décisions scientifiques, sachant exactement où, quoi et quelle quantité planter.
Le comptage des arbres est également né d’un moment de « motivation provocante ». Un jour, la revue « Nature » a publié un article estimant la population d’arbres dans le monde à 3 040 milliards, mais les données sur la Chine étaient insuffisantes. A cette époque, mon équipe et moi travaillions dans les forêts depuis plus de trois ans, accumulant des données substantielles. Je pensais que les forêts chinoises ne devaient pas être une « zone grise » dans la recherche internationale : ce qu’ils pouvaient faire, nous pouvions le faire également.
La Chine est vaste et couvre plus de 9,6 millions de kilomètres carrés de territoire. Comment pouvons-nous compter avec précision chaque arbre ? La clé réside dans la recherche des bonnes méthodes et dans l’exploitation efficace de la technologie. Il y a vingt ans, j’ai vu des universitaires étrangers grimper aux arbres et même y passer des nuits pour mesurer la hauteur des arbres. Tout en admirant leur dévouement, j’ai également réfléchi au fait que la recherche scientifique en arpentage et en cartographie nécessite non seulement un esprit de pragmatisme mais aussi la maîtrise d’outils innovants. En maîtrisant les nouvelles technologies et en allant de l’avant, nous pouvons progresser plus facilement et ouvrir des voies auparavant considérées comme infranchissables. Grâce à des essais répétés, j’ai découvert que le LiDAR est la clé pour résoudre ce défi. Les impulsions laser « va-et-vient » peuvent définir avec précision la hauteur, la forme et les emplacements exacts des arbres, balayant ainsi une forêt entière en un peu plus de dix minutes.
En pratique, nous avons perfectionné un système d’observation « binoculaire » intégrant « le ciel et la terre », semblable à la réalisation d’un scanner pour compter les arbres. Un « œil » est en l’air, avec des drones équipés de capteurs capables de tirer des millions d’impulsions laser par seconde ; l’autre « œil » est au sol, où les équipes transportent des appareils à scanner lorsqu’elles marchent sous la canopée. En combinant des perspectives aériennes, de niveau et ascendantes avec une complémentarité multidimensionnelle de lasers, d’images et de vidéos, les forêts qui étaient autrefois « floues et comptées de manière imprécise » deviennent de plus en plus visibles. Actuellement, le matériel et les logiciels LiDAR que nous avons développés ont été déployés dans plus de 130 pays et régions.
Au cours de la dernière décennie, nous avons étudié plus de 76 000 placettes d’échantillonnage et collecté plus de 400 téraoctets de données. Pour mettre cela en perspective, si nous supposons que chaque photo numérique fait environ 5 mégaoctets, cela équivaut à 80 millions de photos. Gérer un volume aussi énorme d’ingénierie est un processus continu consistant à relever et à surmonter des défis. Par exemple, comment mesurer la hauteur des arbres lorsque le terrain forestier est irrégulier ? Nous avons développé des algorithmes de vol qui permettent aux drones d’ajuster leur altitude en fonction du terrain. Après avoir effectué un « scanner », comment analyser de grandes quantités de « tranches » de forêt ? Nous avons exploré des algorithmes intelligents de segmentation d’arbre unique, permettant au système d’« extraire » automatiquement des arbres individuels de canopées complexes et de générer des cartes de densité d’arbres. Là où il y a une montagne, nous traçons un chemin ; là où il y a de l’eau, nous construisons un pont. La recherche scientifique ne démarre jamais avec un état parfaitement idéalisé : les réalisations se forgent toujours par l’action en créant les conditions nécessaires pour « aller de l’avant ».
Le moment le plus inoubliable pour moi a été la découverte du plus grand arbre d’Asie, dans la région autonome du Xizang (sud-ouest de la Chine). Après avoir traversé la tumultueuse rivière Yigong Tsangpo, nous sommes arrivés sous un genévrier de 102,3 mètres de haut. Comparé à la joie et à la crainte, ce que j’ai ressenti le plus était un profond sentiment de respect et de crainte. Ce n’était pas simplement un arbre, mais une histoire vivante – une profonde révélation que nous avait conférée la nature. Parmi les arbres réside une force inhérente. À l’avenir, je continuerai à travailler en première ligne dans les enquêtes de terrain, en m’efforçant d’affiner le « livre de comptes » numérique de l’écologie naturelle de la Chine et de contribuer davantage à la sauvegarde de cette fondation verte.
(Guo Qinghua est un professeur distingué à la Peking University et directeur de l’Institut de télédétection et des systèmes d’information géographique de l’École des sciences de la Terre et de l’espace de la Peking University. Cet article a été rédigé sur la base d’un entretien par Liu Fawei, journaliste au Quotidien du Peuple.)
.png)
 il y a 1 mois
95
il y a 1 mois
95











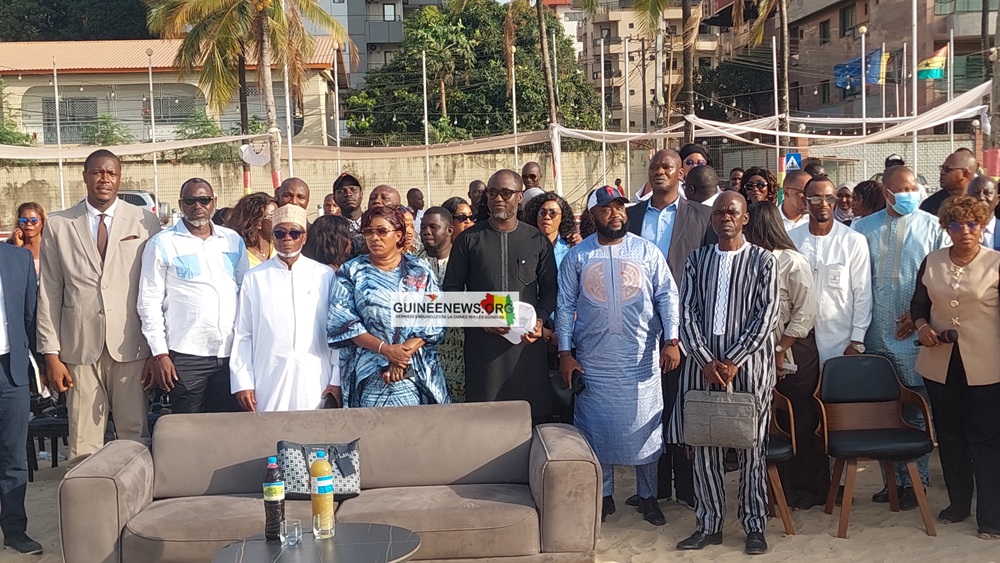







 English (US) ·
English (US) ·