PLACEZ VOS PRODUITS ICI
CONTACTEZ [email protected]

Depuis le retrait du permis de la GAC et la création de la société étatique Nimba Mining, une partie de l’opinion publique s’est emparée avec ferveur de l’idée que la Guinée devrait impérativement se doter de raffineries publiques pour tirer pleinement profit de sa bauxite. L’argument semble évident, si l’État est propriétaire, il garde la totalité des bénéfices. Mais dans l’industrie minière et métallurgique, la réalité économique est plus complexe. Ce n’est pas seulement la propriété qui détermine la richesse captée, mais aussi l’efficacité opérationnelle, la qualité de la gestion, la capacité d’exportation et la solidité des contrats.
D’abord, les expériences internationales montrent que la performance d’une raffinerie dépend moins de la nature de son actionnariat que de sa gouvernance, de la compétence de ses équipes et de sa capacité à s’intégrer dans une chaîne de valeur compétitive. Dans plusieurs pays producteurs, des raffineries publiques à 100 % se sont révélées déficitaires, plombées par une gestion politisée, des sureffectifs, un entretien insuffisant et une faible adaptation aux normes technologiques. À l’inverse, des partenariats équilibrés entre l’État et des investisseurs privés ont permis de sécuriser l’approvisionnement, d’optimiser les coûts et d’assurer un partage équitable des bénéfices, tout en transférant des compétences aux ressources humaines locales.
Ensuite, les chiffres démontrent que l’impact direct en termes d’emplois reste relativement limité, quelle que soit la structure de propriété. La raffinerie de Yarwun, en Australie, avec une capacité de 2,18 millions de tonnes par an, emploie environ 735 personnes. En Inde, l’usine Vedanta de 6 millions de tonnes, combinant raffinerie et fonderie, annonce 200 000 emplois, mais l’immense majorité est indirecte et précaire. Selon les standards industriels, une raffinerie de 3 à 4 millions de tonnes crée entre 600 et 1 200 emplois directs, auxquels s’ajoutent 2 500 à 3 000 emplois indirects. Autrement dit, la clé pour maximiser l’impact socio-économique ne réside pas uniquement dans la détention majoritaire par l’État, mais dans la capacité à multiplier les projets, à favoriser l’intégration locale et à stimuler l’écosystème de services et de sous-traitance.
De plus, l’argument selon lequel une raffinerie publique capterait mécaniquement plus de richesses pour l’État néglige le fait qu’une usine mal gérée peut devenir un gouffre financier, absorbant des ressources publiques qui pourraient être mieux investies ailleurs. Les coûts de construction d’une raffinerie d’alumine de 2 millions de tonnes dépassent souvent le milliard de dollars. Sans apport massif de capitaux et de technologies, le risque est grand de se retrouver avec des infrastructures sous-performantes, incapables de rivaliser avec les producteurs mondiaux à bas coûts comme l’Australie ou l’Indonésie.
C’est pourquoi, plutôt que d’opposer propriété publique et investissement privé, il serait plus judicieux de concevoir un modèle guinéen adapté, reposant sur des partenariats public-privé stratégiques, où l’État conserve une part significative pour peser sur les décisions, tout en s’appuyant sur l’expertise technique, le financement et les réseaux commerciaux des partenaires privés. Un tel schéma permettrait de garantir des revenus stables à l’État, d’assurer un transfert de savoir-faire, de développer un tissu industriel national et de réduire les risques liés à la gestion exclusive par le secteur public.
Pour tester cette idée, j’ai modélisé un cas concret, une raffinerie d’alumine en Guinée, capacité de 3 millions de tonnes par an, sur 20 ans, avec trois modes de propriété différents.
Premièrement, une raffinerie 100 % public (l’État est seul propriétaire et opérateur), deuxièmement, Partenariat Public-Privé (PPP), avec l’État à 34 % du capital et troisièmement, une raffinerie 100 % privé, l’État ne possède aucune action mais encaisse des taxes et redevances.
Hypothèses de départ, prix moyen de l’alumine 350 $/t, coût de construction (CAPEX) 3,6 milliards $, coût de production (OPEX) variant entre 195 et 220 $/t selon l’efficacité, redevance minière 3 %, impôt sur les sociétés 30 %, amortissement linéaire sur 20 ans, taux d’actualisation 10 %. Pour l’emploi, nous nous basons sur des données réelles, donc entre 800 et 1 000 emplois directs pour une usine de cette taille, et deux fois plus en emplois indirects (transport, services, sous-traitance).
Les résultats chiffrés du calcul montrent que sur 20 ans, à prix constant, l’État encaisserait
2,17 milliards $ avec une raffinerie 100 % publique, 1,29 milliard $ avec un PPP (34 % du capital) et 0,92 milliard $ avec une raffinerie privée.
Mais il faut lire ces résultats avec prudence car dans le modèle public, l’État gagne plus, mais il supporte 100 % du risque, surcoûts, pannes, mauvaises gestions. Si le prix de l’alumine chute (par exemple à 300 $/t), la VAN État baisse à 1,30 milliard $.
Dans le modèle PPP, l’État gagne moins mais partage les risques avec un partenaire privé, bénéficie de technologies modernes, et s’assure de transferts de compétences.
Dans le modèle privé, la rentabilité fiscale est la plus faible, mais l’État ne débourse rien pour la construction et reste simple régulateur.
Ces chiffres prouvent que la propriété publique maximise mécaniquement les revenus, mais au prix d’un risque total supporté par l’État d’où l’impératif d’exiger une gestion exemplaire, un pilotage transparent et une gouvernance à l’abri des pressions politiques. À l’inverse, le PPP offre un équilibre, il réduit la part directe captée mais garantit un niveau de performance et de transfert de compétences plus élevé, tout en partageant les risques financiers. Le modèle privé pur est le moins favorable fiscalement, il ne doit être envisagé que si l’État dispose d’autres leviers contractuels pour imposer des obligations de contenu local, de fiscalité et de réinvestissement.
La vraie décision stratégique n’est donc pas de choisir “public” par patriotisme ou “privé” par idéologie, mais de construire un contrat solide qui verrouille l’intérêt national, peu importe la structure du capital. C’est cette rigueur contractuelle qui fera la différence entre une raffinerie qui enrichit vraiment la Guinée et une raffinerie qui enrichit surtout ses actionnaires.
Yakouba Mariame KONATE
Doctorant en Administration des Affaires
Spécialiste en PPP, Mines & Industries
L’article Raffineries en Guinée : Public, Privé ou PPP ? Les chiffres qui changent le débat (Par Yakouba Konaté) est apparu en premier sur Mediaguinee.com.
.png)
 il y a 6 mois
320
il y a 6 mois
320







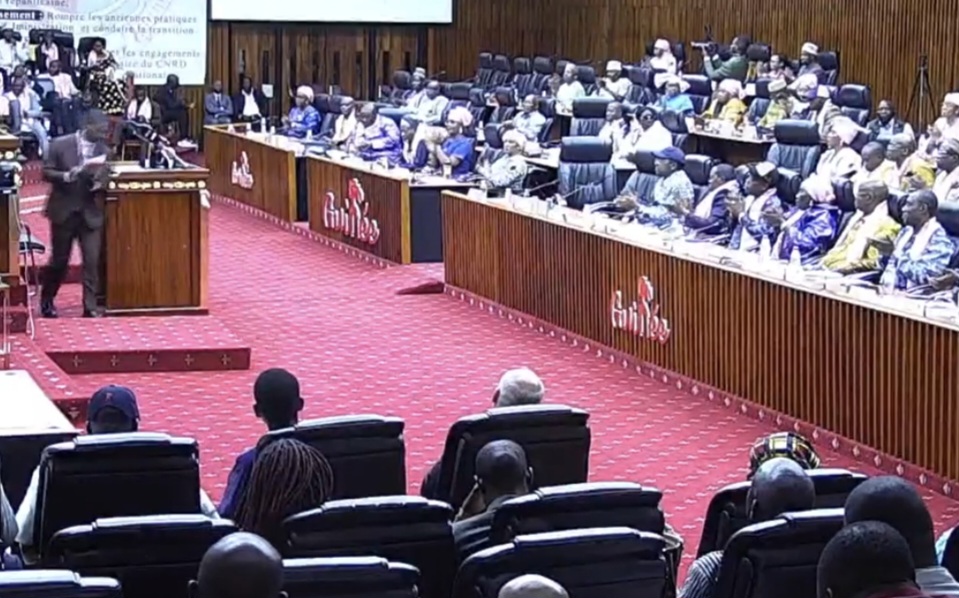










 English (US) ·
English (US) ·