PLACEZ VOS PRODUITS ICI
CONTACTEZ [email protected]

Le retour des militaires sur la scène publique en Afrique de l’Ouest n’est pas un simple hasard. Ils ont su profiter des brèches ouvertes par les civils pour s’y engouffrer. Même si certains refusent de l’admettre, ce comeback résulte de la faillite totale de l’élite politique et du cuisant échec de nombreux chefs d’État civils qui dirigeaient ces pays. Des hommes cupides et égoïstes, incapables d’offrir de meilleures conditions de vie à leurs populations ou de respecter les constitutions sur lesquelles ils ont prêté serment. Pire encore, ils n’ont jamais été en mesure de bâtir des institutions fortes qui, normalement, devraient servir de digues pour empêcher les dérives, prévenir les excès et éviter les violations des textes et des lois. Prenons les cas un par un.
En Guinée, le président déchu Alpha Condé, après plus de quarante ans de lutte politique, accède en 2010 à la magistrature suprême. La Constitution l’autorisait à effectuer deux mandats, puis à passer la main. Il ne le fera jamais. Au contraire, il modifiera le texte fondamental pour briguer un troisième mandat, avançant coûte que coûte, au prix de morts innocentes, uniquement pour satisfaire ses intérêts personnels. La suite est connue : le 5 septembre 2021, il est renversé par les militaires.
Au Mali voisin, alors que le pays était attaqué de toutes parts par les jihadistes et que les violences intercommunautaires se multipliaient, le président Ibrahim Boubacar Keïta se contentait de verser des larmes de crocodile sur les Champs-Élysées à chaque tragédie survenue en France. On se souvient également des images choquantes de son fils, Karim Keïta, en yacht sur une plage espagnole, en pleine fête entouré de jeunes filles soigneusement sélectionnées, pendant que le Malien lambda tirait le diable par la queue dans une vie quotidienne extrêmement difficile. Là encore, nous connaissons la suite.
Au Burkina Faso, la population a vécu sous une chape de plomb durant les vingt-sept années de règne de Blaise Compaoré. Renversé par une insurrection populaire en 2014, l’ancien président s’est exilé en Côte d’Ivoire. Après son départ, une transition militaire et civile a conduit à l’élection d’une « marionnette de la France », Roch Marc Christian Kaboré, comme président de la République. Lui aussi sera renversé par les militaires, en raison de la dégradation de la situation sécuritaire.
Au Niger, après deux mandats, Mahamadou Issoufou choisit de soutenir son ministre de l’Intérieur, Mohamed Bazoum, pour lui succéder. Ce dernier est déclaré vainqueur de l’élection présidentielle au second tour face à Mahamane Ousmane, dont les partisans contestent les résultats dans la rue en dénonçant des fraudes. Bazoum sera finalement renversé deux ans plus tard par les militaires, qui justifient leur coup d’État par « la dégradation continue de la situation sécuritaire » et « la mauvaise gouvernance économique et sociale ». Depuis, ce sont les militaires qui occupent les bureaux du palais présidentiel.
Le dernier cas en date est celui de la Guinée-Bissau. À un an de la fin de son quinquennat, Umaro Sissoco Embaló annonce publiquement qu’il ne se représentera pas à la prochaine élection présidentielle, affirmant qu’il ne laissera pas le pays entre les mains de « bandits », un terme emprunté à Alpha Condé. Il va jusqu’à se moquer ouvertement des présidents s’octroyant un troisième mandat, qu’il qualifie de « coup d’État constitutionnel ». Finalement, il change d’avis, se présente à la présidentielle et revendique la victoire au même titre que son challenger, Fernando Dias. Dans ce climat confusionnel, un groupe de militaires annonce avoir pris le pouvoir par la force. Même si plusieurs sources évoquent un scénario orchestré par Embaló lui-même, la Guinée-Bissau entre dans une nouvelle période d’incertitude. La faute à un président qui, comme les autres, a failli à ses responsabilités.
Dans d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, il n’y a pas encore eu de coup d’État, du moins pour l’instant, mais la situation politique, économique et institutionnelle n’est guère plus reluisante.
Les Ivoiriens, qui ont connu plusieurs années de guerre et d’instabilité politique, élisent en 2010 Alassane Ouattara à la Présidence de la République. Six ans plus tard, il modifie la Constitution en supprimant la limite d’âge, ce qui remet les compteurs à zéro. Aujourd’hui, le président ivoirien en est à son quatrième mandat, comme si aucun Ivoirien n’était capable d’assumer les fonctions de chef de l’État. Même s’il a profondément transformé le pays à travers la construction d’infrastructures de grande envergure, cette modification constitutionnelle demeure la plus grande tache noire de sa présidence. Nul ne peut prédire ce qui se passera en Côte d’Ivoire après son départ. Les institutions sont-elles suffisamment solides pour garantir une transition pacifique ? Telle est la grande question.
Le Sénégal, longtemps considéré comme un modèle de stabilité et de démocratie en Afrique de l’Ouest, inquiète désormais. Le pays traverse une crise institutionnelle sans précédent, avec un Premier ministre qui semble refuser de se soumettre à l’autorité du président de la République, prétextant qu’il est le véritable leader du mouvement politique ayant porté l’actuel président au pouvoir. Jusqu’à quand ce bras de fer entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye va-t-il durer, et quelles en seront les conséquences ? L’avenir nous le dira. En attendant, le pays fait face à une crise économique et politique réelle.
.png)
 il y a 1 mois
80
il y a 1 mois
80










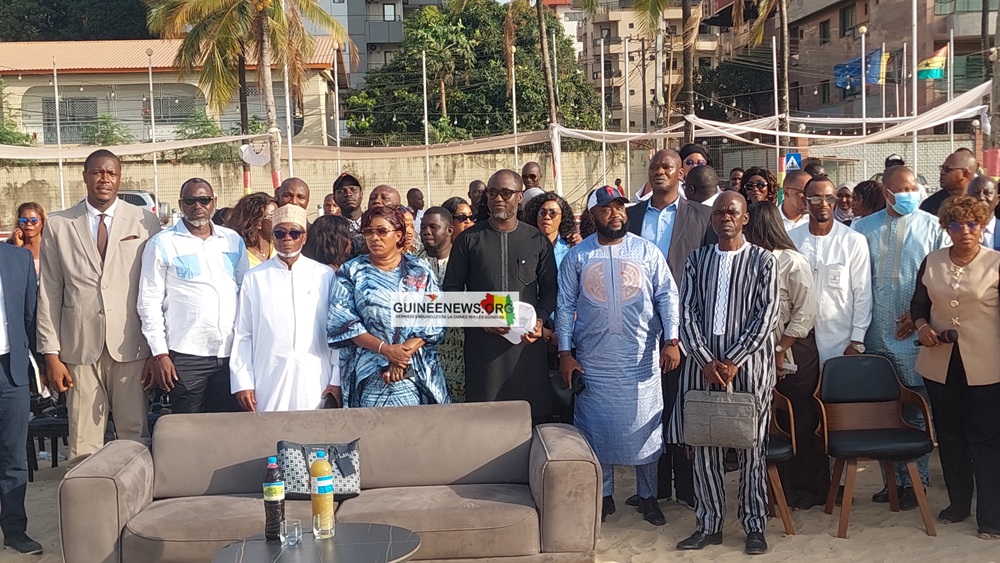








 English (US) ·
English (US) ·