PLACEZ VOS PRODUITS ICI
CONTACTEZ [email protected]

Ces derniers temps, la Guinée connaît presque chaque jour une catastrophe liée aux inondations dans une région. Parfois, ces fortes pluies entraînent également des pertes en vies humaines et des dégâts matériels énormes. Il est nécessaire d’adopter des mesures légales et administratives concernant les précautions à prendre dans ce domaine. À chaque saison pluvieuse en Guinée particulièrement à Conakry (la capitale), il y a de lourdes pertes humaines, matérielles et infrastructurelles. Les précipitations abondantes, allant de mai à octobre, provoquent des inondations meurtrières, qui désorganisent la vie socio-économique et exposent les carences structurelles de la ville en matière de gouvernance urbaine, de gestion environnementale et de prévention des risques climatiques. La pluie n’est plus une bénédiction, mais une tueuse d’hommes.
C’est vrai que les pluies soient d’origine naturelle, les dégâts qu’elles entraînent sont en grande partie le fruit de défaillances humaines. L’urbanisation désordonnée en Guinée, la saturation des canaux d’évacuation, l’absence de planification urbaine rigoureuse et le manque de dispositifs de résilience accentuent la vulnérabilité de la ville de Conakry et de l’intérieur. Des quartiers densément peuplés comme Dabomdi, Bonfi, Conronthie, Hamdallaye, Matoto, Cosa ou Yimbaya sont régulièrement submergés avec pour conséquences l’effondrement d’habitations, des pertes en vies humaines (les enfants, les femmes, en général les personnes démunies) une paralysie de la mobilité urbaine. Ce qui rend cette situation d’autant plus préoccupante, c’est le caractère évitable de ces drames par faute de manque d’action concrète des pouvoirs publics pour minimiser les risques. Il est vrai que des inondations meurtrières surviennent partout dans le monde, comme aux États-Unis, en France ou en Chine. Chaque saison devrait être une occasion d’apprendre et de lutter efficacement contre ce fléau. Cependant, dans nos pays, aucune action ferme n’est engagée pour résoudre ce problème, et tout se limite souvent à des discours de circonstance.
L’épisode pluvieux de ce mois de juillet 2025 constitue une illustration tragique de cette situation catastrophique, au cours duquel plusieurs décès ont été enregistrés en l’espace de quelques heures à Conakry (Sangoyah, Dabompa et autres lieux non énumérés) en raison de l’insuffisance des infrastructures de drainage et de l’occupation illégale de zones à risque, notamment les zones marécageuses. Malgré les alertes météorologiques répétées et les appels au secours des riverains, les réponses institutionnelles restent insuffisantes, voire absentes. Les fossés d’évacuation sont rarement entretenus, les systèmes d’alerte peu fonctionnels, et les dispositifs d’urgence mal coordonnés.
La responsabilité est partagée entre les citoyens et l’État. Si la précarité pousse certaines populations à s’installer dans des zones non sécurisées, il revient à l’État, garant de l’aménagement du territoire, d’anticiper, de réguler et de protéger. Or, les initiatives publiques en matière de relogement ou de drainage souffrent d’un déficit chronique de financement, de planification cohérente et de volonté politique. À cela s’ajoute un faible niveau de civisme environnemental : le dépôt anarchique d’ordures dans les caniveaux aggrave l’engorgement des voies d’évacuation et accentue les risques d’inondation. Car si l’on abuse de l’environnement, celui-ci finit par se retourner contre nous.
Face à cette crise persistante, il devient urgent d’agir à plusieurs niveaux. D’un point de vue technique, il est crucial de cartographier précisément les zones vulnérables, d’interdire formellement les constructions illégales et de mettre en place un programme régulier de nettoyage des canaux d’évacuation. Sur le plan social, une campagne nationale de sensibilisation sur la gestion des déchets et la protection de l’environnement urbain s’impose. Et au niveau institutionnel, il faut adopter un plan global de gestion des inondations, avec un budget suffisant, un calendrier bien défini et un système de suivi indépendant. Conakry ne peut plus continuer à déplorer des morts et des dégâts à chaque épisode pluvieux. La pluie, qui est une source de vie, ne devrait jamais se transformer en une cause de souffrance. Ce fléau résulte avant tout d’un manque de planification, de coordination et de responsabilité collective. Il est grand temps de changer cette situation grâce à une gouvernance urbaine proactive et inclusive.
Dr. Ibrahima CHERIF
L’article Quand il pleut, Conakry pleure ses morts (Par Dr. Ibrahima CHERIF) est apparu en premier sur Mediaguinee.com.
.png)
 il y a 6 mois
272
il y a 6 mois
272







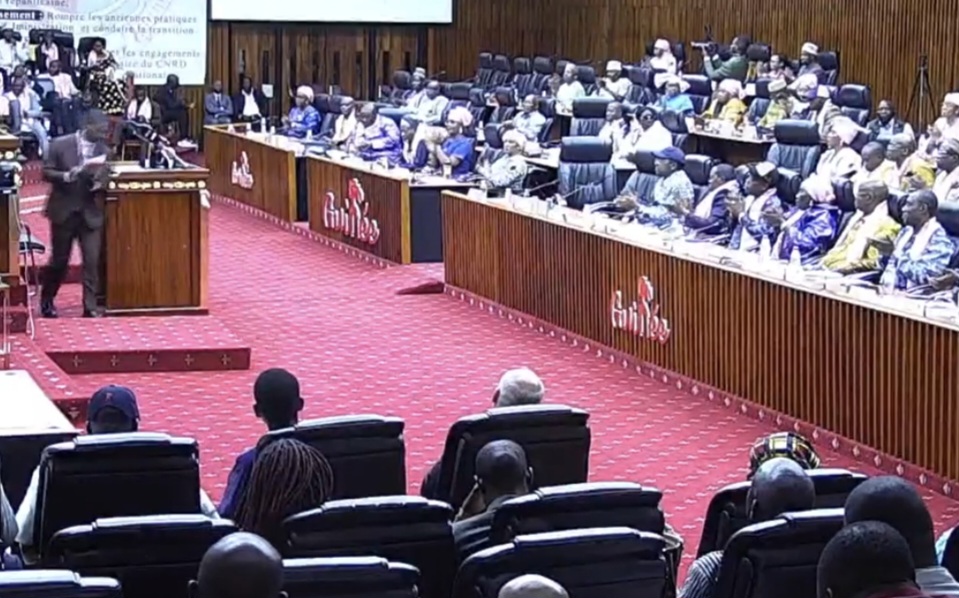









 English (US) ·
English (US) ·