PLACEZ VOS PRODUITS ICI
CONTACTEZ [email protected]
À chaque nomination d’un nouveau gouvernement en Guinée, une scène revient de manière quasi rituelle : celle des ministres, main posée sur le Coran ou la Bible, prêtant serment de loyauté envers la République, le peuple et leurs devoirs d’État. Cette cérémonie solennelle, profondément ancrée dans le protocole d’investiture, soulève une question essentielle : ce serment, prêté sur des textes religieux, a-t-il un véritable poids dans la gouvernance publique ou ne constitue-t-il qu’une formalité symbolique ?
Un engagement solennel… mais sans sanction directe
Sur le plan juridique, le serment est un acte moral et politique par lequel le ministre s’engage publiquement à respecter la Constitution, les lois de la République, ainsi que les obligations de sa charge. En Guinée, les textes prévoient que ce serment soit prêté devant le Président de la République, sur le Coran ou la Bible, selon la foi du concerné.
Cependant, cet acte n’a pas de valeur juridique contraignante directe. La violation du serment n’entraîne pas automatiquement de sanction, sauf si elle est accompagnée d’actes illégaux avérés : corruption, abus de pouvoir, détournement de fonds, etc. Ainsi, le serment seul ne suffit pas à garantir la probité du fonctionnaire.
Une dimension religieuse à double tranchant
Dans un pays à majorité musulmane comme la Guinée, le serment religieux a un poids spirituel important. En islam comme dans le christianisme, jurer au nom de Dieu implique une responsabilité morale majeure, et le parjure est considéré comme un grave péché.
Mais cette dimension sacrée peut aussi devenir un outil d’illusion, voire de manipulation. Prêter serment sur le Coran pour ensuite trahir son mandat n’est pas seulement une faute envers l’État ; c’est un manquement éthique et spirituel grave. Cela contribue à éroder la confiance des citoyens envers leurs dirigeants, et à banaliser les valeurs morales dans l’exercice du pouvoir.

Entre hypocrisie institutionnelle et vide de responsabilité
Malheureusement, la pratique révèle une autre réalité : le serment devient souvent un acte de façade, vidé de sa portée morale et politique. Nombreux sont les ministres qui prêtent serment en public pour ensuite, en privé, user de leur fonction à des fins personnelles, clientélistes ou partisanes.
Cela renforce l’idée selon laquelle le serment ne remplace pas les mécanismes de contrôle et de sanction, tels qu’un Parlement fort, une justice indépendante, des institutions de reddition de comptes efficaces, ou encore une société civile vigilante.
Vers une réhabilitation du serment : entre foi, loi et redevabilité
Il ne s’agit pas de supprimer le serment religieux, mais de lui redonner sa cohérence. Cela passe par :
– Une formation éthique des dirigeants dès leur entrée en fonction,
– Une vigilance institutionnelle accrue pour suivre le respect effectif des engagements,
– Une sanction politique, judiciaire ou morale pour ceux qui trahissent leur serment,
– Et surtout, la promotion d’une culture de la redevabilité, où chaque acte public est pesé, mesuré et évalué.
Conclusion : le serment doit redevenir un pacte avec le peuple et avec Dieu
Le serment prêté sur le Coran ou la Bible ne doit pas être vu comme un simple geste rituel. Il est un double engagement : devant Dieu et devant le peuple. Le trahir revient à rompre un pacte sacré. Pour qu’il ait un sens, il doit s’accompagner d’un système de responsabilité rigoureux, d’une justice impartiale et d’une conscience morale vivante.
La Guinée ne changera pas par des cérémonies solennelles, mais par la sincérité dans l’action publique, la loyauté envers les institutions et l’amour du peuple. Ce n’est qu’à ce prix que le serment retrouvera sa force… et sa vérité.

Mohamed Chérif Touré
Juriste, expert en droit public et coopération judiciaire
[email protected]
.png)
 il y a 6 mois
395
il y a 6 mois
395










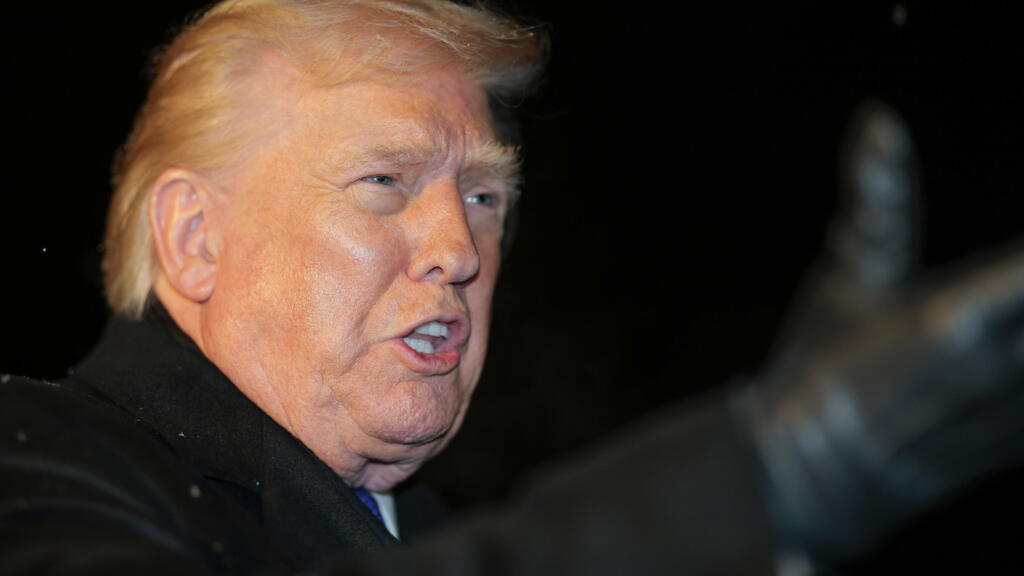








 English (US) ·
English (US) ·