PLACEZ VOS PRODUITS ICI
CONTACTEZ [email protected]
Avec le projet de nouvelle Constitution, dont l’article 5 officialise non seulement les langues nationales mais consacre également leur enseignement, un pas majeur a été franchi, offrant un environnement juridique assaini et propice à leur épanouissement.
Les expériences d’enseignement des langues nationales sous la Première République ont jeté les bases de leur intégration dans le système éducatif guinéen. La première promotion avait atteint le niveau du BEPC en 1984 avant d’être brutalement interrompue pour des raisons davantage politiques que techniques ou pédagogiques.
Aujourd’hui, des études objectives ont permis d’analyser les forces et les faiblesses de cet enseignement entre 1968 et 1984. Je consacrerai d’ailleurs un article spécifique aux atouts et aux limites de l’expérience guinéenne en matière d’enseignement des langues nationales sous Ahmed Sékou Touré, telle qu’analysée par des pédagogues et spécialistes des sciences de l’éducation.
Par ailleurs, les états généraux de l’éducation, tenus entre les années 1990 et 2008, ont recommandé la réintégration des langues nationales à l’école. Cette volonté a été réaffirmée par la loi d’orientation de l’éducation de 1997, qui reconnaît aux langues nationales le droit d’être des langues d’enseignement dans les écoles guinéennes.
Le Symposium sous-régional sur le bilinguisme scolaire, organisé à Conakry en 2003, ainsi que les états généraux de l’éducation de 2008, ont également formulé des recommandations en faveur de leur introduction. Toutefois, malgré ces avancées conceptuelles, les décideurs politiques n’ont jamais suivi les orientations des experts, et la réintégration effective des langues nationales dans le système scolaire n’a jamais été actée.
Néanmoins, plusieurs expérimentations ont émergé et perdurent jusqu’à aujourd’hui. Parmi elles :
1. L’expérience de bilinguisme mandenkan (transcription N’ko) – français, initiée en 1995 et toujours en cours. Actuellement, une vingtaine d’écoles primaires en Haute-Guinée appliquent ce modèle. Les élèves y apprennent leur langue maternelle à travers l’écriture N’ko tout en étudiant le français avec l’alphabet latin. À l’examen d’entrée en 7ᵉ année, ils sont évalués uniquement en français, puis poursuivent leur scolarité dans les collèges et lycées classiques. Les premières promotions ont achevé leurs études universitaires il y a longtemps. Une étude pédagogique américaine a évalué ces écoles et ses résultats sont encourageants.
2. L’initiative ELAN (École et Langues Nationales en Afrique), lancée en 2018 sous l’impulsion de la Francophonie. Elle concerne 16 écoles primaires bilingues (sosso-français) dans la préfecture de Kindia. Aujourd’hui, ELAN est déployé dans 15 pays africains francophones subsahariens. Une évaluation menée par l’OIF a confirmé le succès de ce projet.
Dans le domaine de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes, outre le N’ko, des systèmes innovants comme les écritures Adlam et Koresebeli contribuent à la lutte contre l’analphabétisme.
En conclusion, la Guinée constitue le plus vaste champ d’expérimentation de l’enseignement des langues nationales en Afrique francophone. De nombreuses études documentent ces initiatives, offrant aujourd’hui une solide base pour relancer cet enseignement en capitalisant sur les succès et les échecs passés. Cet héritage constitue un atout majeur pour la Guinée à un moment où d’autres pays africains s’engagent dans cette voie.
Le principal défi reste politique, mais avec l’article 5 de la nouvelle Constitution, qui institutionnalise les langues nationales et leur enseignement, le cadre juridique est désormais favorable à leur développement.
Ibrahima Sory 2 Condé (alias Nafadji Sory)
Directeur national adjoint de l’Alphabétisation, de l’Éducation non formelle et de la Promotion des langues nationales
.png)
 il y a 6 mois
312
il y a 6 mois
312
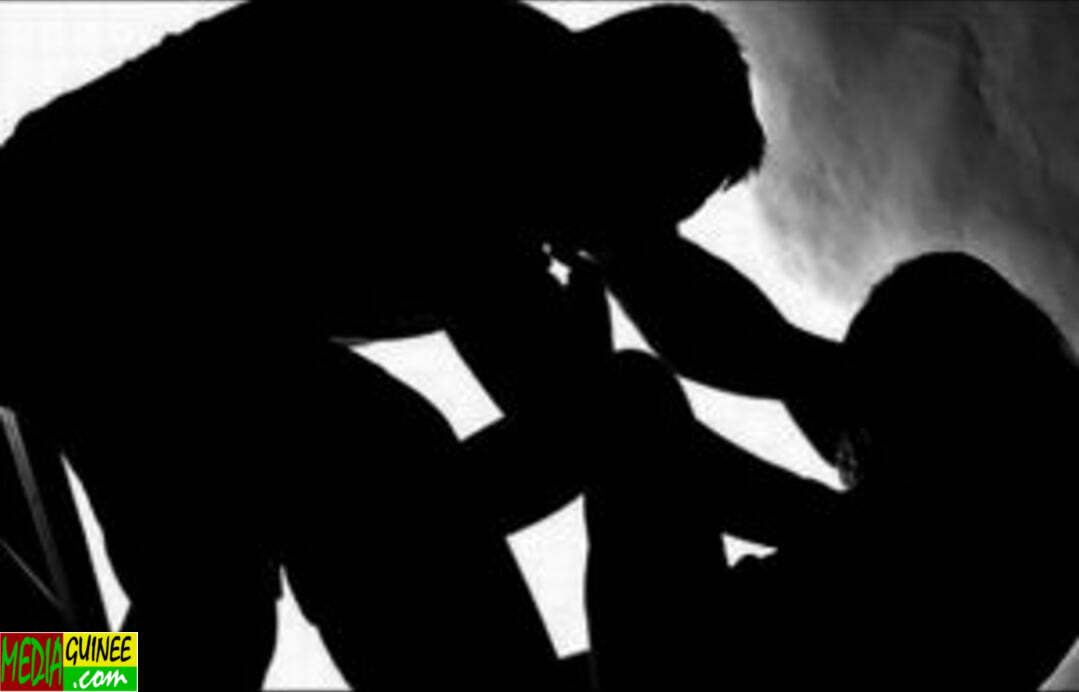



















 English (US) ·
English (US) ·