PLACEZ VOS PRODUITS ICI
CONTACTEZ [email protected]

La recrudescence de la criminalité et la violation systématique des droits humains en République de Guinée deviennent de plus en plus inquiétantes et préoccupantes ; ces deux phénomènes constituent de nos jours une problématique majeure caractérisée par des séries d’assassinats et des actes de torture insoutenables infligés aux présumés auteurs de crimes odieux ou de tout autre acte préjudiciable.
Certains de ces actes cruels et rétrogrades, qui se multiplient du jour au lendemain dans plusieurs villes du pays, comme l’assassinat de Mme Adama Konaté à Kankan, de Dr Aboubacar Touré à Coyah et de Boubacar Diallo, retrouvé mort dans son atelier de couture à Bambeto, remettent en question la capacité opérationnelle de nos services de sécurité et de protection des personnes et de leurs biens (I), mais aussi et surtout l’efficacité de nos institutions judiciaires (II).
La question qui se pose ici est celle de la responsabilité des autorités. Comment en sommes-nous arrivés là ? Pourquoi de telles dérives sont-elles tolérées par une société qui, jadis, avait un certain respect de la vie humaine et de la justice ?
C’est pourquoi un diagnostic profond des variables explicatives de la résurgence de ces crimes odieux récemment commis, ainsi que des atteintes graves aux droits humains, et une approche multidimensionnelle incluant le rôle déterminant de l’appareil judiciaire et des services de sécurité seront incontournables pour lutter efficacement contre ces fléaux d’un autre âge.
I – Les mécanismes de sécurité et de protection des personnes et de leurs biens : un autre talon d’Achille des nouvelles autorités
La République de Guinée connaît actuellement une recrudescence inquiétante de l’insécurité, marquée par la multiplication d’actes criminels tels que les assassinats, les enlèvements, les vols à main armée, les agressions, ainsi que divers actes de violence et de torture.
Cette situation désastreuse affecte dangereusement le climat de sécurité, de paix et de quiétude sociale. C’est pourquoi il serait important, dans une large mesure, de questionner l’efficacité de notre système de sécurité et de protection des personnes et de leurs biens (A), mais aussi d’interpeller l’État afin qu’il prenne des dispositions urgentes contre les actes de torture inouïe infligés aux présumés auteurs des infractions susmentionnées (B).
A – De la responsabilité des services de sécurité et de protection des personnes et de leurs biens
Les services de sécurité et de protection des personnes et de leurs biens (police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, etc.) jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la criminalité. Leur action s’inscrit dans une approche à la fois préventive et répressive, visant à assurer la sécurité et le bien-être des citoyens.
De nos jours, ce rôle régalien dévolu à l’État demeure sujet à caution, dans la mesure où les populations vivent dans un climat de peur et de psychose sociale, bref, dans une insécurité grandissante due à la montée en puissance de la criminalité.
Lors d’une tournée à l’intérieur du pays, le général de division Djenaba Sory Camara a dressé un réquisitoire sévère sur les conditions de travail des agents de la police nationale, mettant en lumière un certain nombre de défaillances organisationnelles et structurelles dans le dispositif sécuritaire.
En dehors des problèmes liés aux équipements (véhicules, armes, caméras de surveillance, bases de données numériques, analyse criminelle), il a souligné le nombre extrêmement faible d’agents de sécurité et de forces de l’ordre par rapport aux besoins de la population, ce qui limite leur capacité opérationnelle.
Par ailleurs, certains agents ne se contentent pas de manquer à leur devoir : ils sont impliqués dans des réseaux criminels, entravant les enquêtes et protégeant des criminels notoires. De plus, ils se livrent à des pratiques peu orthodoxes, telles que la corruption.
Ensuite, le faible niveau de vigilance et de rigueur lors du recrutement des agents des services de sécurité, le déficit de formations modulaires adéquates, ainsi que l’insuffisance des moyens matériels et financiers compromettent l’atteinte des objectifs assignés aux services de sécurité et de protection des personnes et de leurs biens.
Cette défaillance manifeste dans le fonctionnement des services de sécurité en matière de lutte contre la criminalité entraîne plusieurs conséquences, notamment l’amplification de l’insécurité et de la criminalité, la crise de confiance entre les citoyens et les agents de sécurité, l’impunité, la corruption et la violation systématique des droits humains.
B – La banalisation de la vie humaine
Récemment, les images diffusées sur les réseaux sociaux, faisant état de l’assassinat de Mme Adama Konaté par Bangaly Traoré, ainsi que de ceux de Dr Aboubacar Touré et de Boubacar Diallo, ont provoqué la révolte et l’indignation des populations.
Pour la première victime, Mme Adama Konaté, assassinée le jeudi 20 mars 2025 au quartier Banankoroda, dans la commune urbaine de Kankan, les vidéos filmées sur les lieux du crime montraient son bourreau tenant dans ses mains le couteau qui lui a servi à commettre son forfait.
Cet homme, à en croire ses premières déclarations, est un récidiviste, un psychopathe qui déambulait en toute liberté. Il ne manifestait ni remords ni crainte d’avoir ôté la vie d’une mère de famille, sous le regard impuissant d’une foule mobilisée pour la circonstance et l’inaction coupable des agents de sécurité.
Devant l’ignominie de son acte, il avançait d’un pas à l’autre, le regard vide, mais l’esprit bouillonnant de rage, prêt à récidiver avant d’être finalement mis aux arrêts. Les images diffusées sur les réseaux sociaux ont, sans nul doute, heurté la sensibilité des citoyens, notamment celle de ses enfants, qui ont vu leur mère gisant dans son propre sang.
Le lendemain matin, c’est l’assassinat de Dr Aboubacar Touré à son domicile privé qui a bouleversé l’opinion. À ce jour, sa famille demeure dans un profond désarroi, car ni les circonstances de son assassinat, ni ses raisons, encore moins l’identité de ses bourreaux, n’ont fait l’objet d’une communication officielle.
Comme si cela ne suffisait pas, un autre compatriote, Aboubacar Diallo, a été retrouvé mort dans son atelier de couture.
Ainsi, face à cette insécurité grandissante et inquiétante, il est impératif de questionner la responsabilité de nos institutions judiciaires.
II – Les institutions judiciaires face à la montée en puissance de la criminalité et à la violation des droits humains
En matière de lutte contre la criminalité et la violation systématique des droits humains, les institutions judiciaires jouent un rôle de premier plan.
Toutefois, au regard de la recrudescence des cas d’assassinats et de violations des droits humains en République de Guinée, le constat révèle une certaine défaillance de l’appareil judiciaire. En raison de défis structurels, financiers et organisationnels qui limitent souvent ses actions (A), la justice peine à remplir efficacement sa mission. Par conséquent, cette situation pousse, à bien des égards, certains citoyens à se faire justice eux-mêmes (B), dans la mesure où les présumés auteurs bénéficient, dans une large mesure, d’une totale impunité.
A – La justice guinéenne face à l’épreuve de la criminalité et de la violation des droits humains
Le droit à la vie est un droit fondamental reconnu par les principales déclarations et conventions internationales relatives aux droits humains. Il est inscrit dans l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et dans l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966.
En plus, l’article 4 de la Charte africaine des droits de l’homme stipule que « la personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être arbitrairement privé de ce droit. »
De même, l’article 10 de cette Charte affirme que « la personne humaine est sacrée et que toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale, de son identité, ainsi qu’à la protection de son intimité et de sa vie privée. »
Or, comme mentionné précédemment, le dysfonctionnement des services de sécurité et des institutions judiciaires en République de Guinée a entraîné des conséquences immédiates, au premier rang desquelles figurent la montée en puissance de la criminalité sous toutes ses formes et la violation systématique des droits humains.
Aujourd’hui, l’insécurité devient de plus en plus préoccupante, comme l’illustre la recrudescence des assassinats enregistrés ces derniers jours. À cela s’ajoute le traitement infligé aux présumés auteurs de ces infractions ou d’autres pratiques préjudiciables.
Concernant l’inefficacité des institutions judiciaires dans la lutte contre la criminalité, il faut avoir le courage de mentionner plusieurs facteurs aggravants : la lenteur des procédures judiciaires, le manque de moyens financiers et matériels pour diligenter des enquêtes rigoureuses, le laxisme judiciaire dans les affaires impliquant certains agents des forces de l’ordre, la surpopulation carcérale et le manque de volonté politique pour durcir les lois face à la gravité des crimes commis.
Face à cet état de fait, ne croyant plus en leur système judiciaire, certains citoyens en viennent à recourir à la justice personnelle ou à la violence.
B – Le recours à la vindicte populaire
La vindicte populaire, également appelée justice populaire, désigne les actions où des individus ou des foules prennent l’initiative de sanctionner eux-mêmes des personnes suspectées de crimes ou de délits, sans passer par les voies légales.
En Guinée, ce phénomène devient de plus en plus fréquent et préoccupant. Nous assistons parfois à des scènes ubuesques où des présumés auteurs d’infractions sont battus à mort ou brûlés vifs par des foules en colère.
Sur les réseaux sociaux, il n’est pas rare de voir certains citoyens se rendre justice au détriment de l’appareil judiciaire. Par exemple, à Kankan, dans la matinée du 9 mars 2024, un présumé voleur de moto a été tabassé à mort dans le quartier de Briqueterie. Puis, à N’Zérékoré, un autre présumé criminel a été lynché à mort le 22 mars 2024 par une foule en colère.
En février 2025, Oumar Bella Bah, appréhendé lors d’une tentative de vol, a été mortellement agressé par des jeunes dans le quartier Koloma Soloprimo. Récemment, des images de tortures infligées aux présumés auteurs d’infractions ont circulé sur les réseaux sociaux, sans que les responsables ne soient inquiétés par quoi que ce soit.
Toutefois, il convient de noter que la diffusion d’images de torture infligées à des présumés auteurs de délits ou de crimes soulève des problèmes éthiques, juridiques et humanitaires. Cette pratique peut, à long terme, causer des troubles psychiques et psychologiques chez les victimes, leurs proches, voire même le public.
Par ailleurs, la vindicte populaire est une pratique qui bafoue la vie humaine ; elle viole le principe de la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable. C’est pourquoi il est indispensable de renforcer les mécanismes de l’État de droit, de sensibiliser la population aux dangers de la justice extrajudiciaire, et d’améliorer l’efficacité du système judiciaire afin de restaurer la confiance des citoyens.
En conclusion, la lutte contre la criminalité nécessite une réponse multisectorielle qui doit mettre un accent particulier sur des services de sécurité bien formés, bien équipés et intègres. De plus, les autorités doivent promouvoir la transparence dans la conduite des enquêtes, rendre les résultats de ces enquêtes disponibles pour toutes fins utiles, améliorer la formation des agents, moderniser les outils de lutte contre la criminalité, instaurer une véritable coopération entre les forces de sécurité et la population, et rendre les procès criminels publics afin de dissuader les citoyens et promouvoir la justice, garantissant ainsi la sécurité et la protection des personnes et de leurs biens.
Aly Souleymane Camara, analyste politique et consultant des médias
L’article La banalisation de la vie humaine et la violation des droits humains en Guinée [Aly Souleymane Camara] est apparu en premier sur Mediaguinee.com.
.png)
 il y a 10 mois
244
il y a 10 mois
244




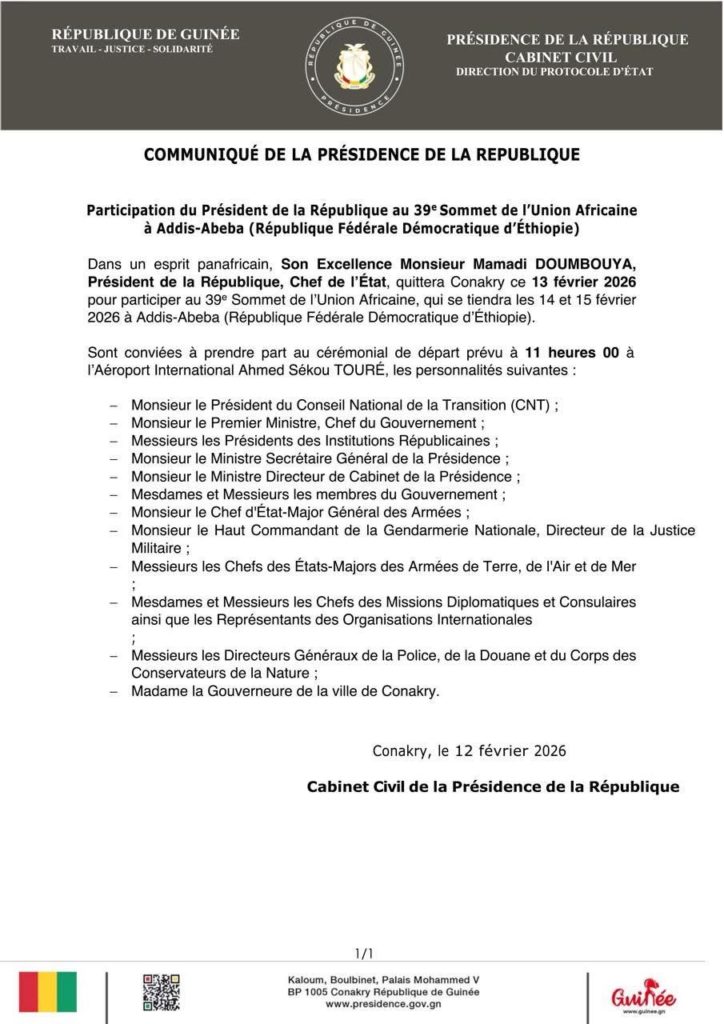













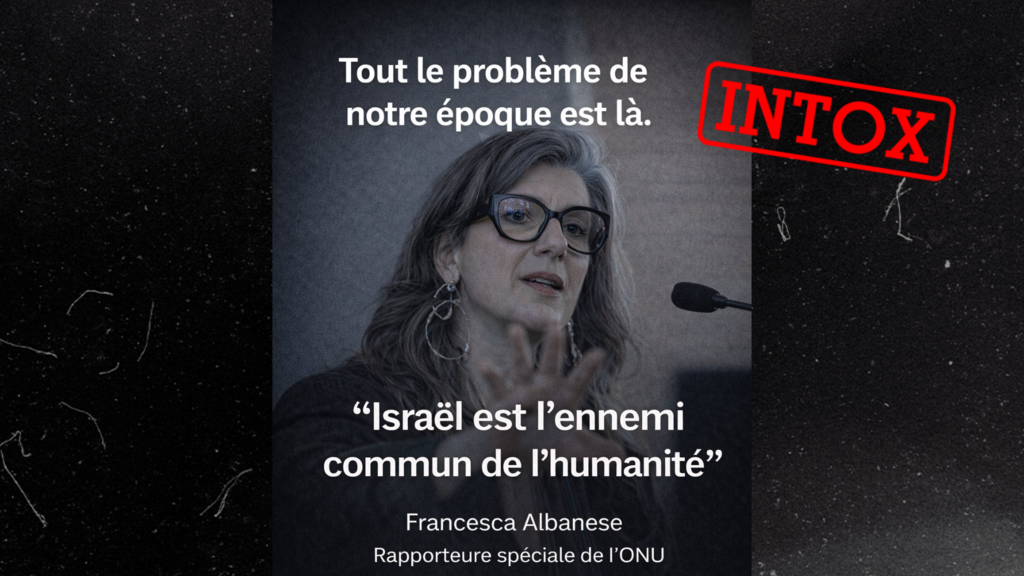
 English (US) ·
English (US) ·