PLACEZ VOS PRODUITS ICI
CONTACTEZ [email protected]
Par Yakouba Mariame KONATE, spécialiste en Partenariats Public-Privé, politique industrielle & Développement minier : Une fois encore, la pluie a frappé, et le deuil est revenu. Cette semaine de fin juillet 2025, plus de sept personnes ont perdu la vie dans différents quartiers de Conakry, notamment à Simanbossiyah, Sangoyah, Antag et Cobayah. Certaines ont été emportées par les eaux, d’autres ensevelies par des glissements de terrain. Des familles entières ont vu leurs biens détruits, leurs enfants blessés, leurs espoirs noyés. Comme à chaque saison pluvieuse, la capitale guinéenne est redevenue un champ de ruines, une ville sans défense face à l’eau, sans plan face au risque, sans voix pour porter les douleurs récurrentes de ses habitants.
Pourtant, cette situation n’a rien d’imprévisible. Elle est le produit d’un enchaînement connu de facteurs, une urbanisation non maîtrisée, une gestion défaillante des déchets, un réseau de drainage obsolète, une absence de planification urbaine, et une politique de relogement inexistante. En clair, les inondations à Conakry sont le reflet d’une faillite systémique et prolongée de la gouvernance urbaine.
D’abord, il faut comprendre que la majorité des infrastructures hydrauliques de Conakry datent de plus de 40 ans. Le réseau d’évacuation des eaux pluviales, conçu à l’époque pour une population de 700 000 personnes, est aujourd’hui complètement dépassé, alors que la ville compte plus de 2,2 millions d’habitants, selon les données du dernier recensement général de la population. À ce facteur s’ajoute la prolifération incontrôlée des habitats précaires. On estime que près de 40 % des ménages de la capitale vivent dans des zones informelles, souvent situées en contrebas, en bord de mer, ou sur des marécages. Ces quartiers comme Dar-Es-Salam, Kaporo ou Wanindara, Antag, Kissosso…, sont devenus des pièges hydrauliques où l’eau stagne, déborde et détruit tout sur son passage.
Mais ce n’est pas tout. Le problème est aggravé par une gestion des déchets catastrophique. Selon une étude conjointe de l’UN-Habitat et de l’Agence nationale de l’assainissement (2023), 94 % des déchets solides produits chaque jour à Conakry ne sont ni collectés ni traités de manière professionnelle. Faute de bacs, de collecte régulière et de sensibilisation, ces déchets finissent dans les caniveaux, bouchant les canaux d’évacuation et provoquant leur débordement. Une simple pluie de deux heures suffit alors à transformer une rue en fleuve, un quartier en marécage, un foyer en tombeau.
Or, d’autres pays africains ont déjà été confrontés à des défis similaires, mais ont su y faire face avec des réponses structurelles, durables et efficaces. Le cas du Sénégal est un exemple frappant. À Dakar, après les inondations meurtrières de 2009 (plus de 100 000 sinistrés), les autorités ont lancé le Projet de Gestion des Eaux Pluviales et d’Adaptation au Changement Climatique (PROGEP) avec l’appui de la Banque mondiale et de l’AFD. Ce projet a permis la construction de 22 kilomètres de canaux primaires et secondaires, la création de bassins de rétention naturels (notamment à Dalifort et Pikine) et l’aménagement de 2 000 hectares de zones tampons vertes. Résultat, 150 000 personnes ont été sorties des zones inondables entre 2012 et 2021, avec une réduction de 40 % des dégâts matériels en saison de pluie.
En Côte d’Ivoire, à la suite de la catastrophe de juin 2018 (18 morts en une nuit à Abidjan), le gouvernement a réagi avec la mise en œuvre du Plan d’Urgence pour l’Assainissement et le Drainage (PUAD). Ce plan, financé à hauteur de 460 milliards FCFA sur 10 ans, prévoit la construction de barrages hydrauliques, de bassins de rétention bétonnés, ainsi que la réhabilitation de 300 kilomètres de canalisations dans les communes d’Abobo, Cocody et Yopougon. Déjà, plusieurs quartiers auparavant inondables comme Angré ou Gesco enregistrent une amélioration notable.
Même à Kigali, capitale du Rwanda, l’État a investi dans des solutions de ville résiliente et verte. Grâce à une politique stricte de zonage, au recasement progressif des populations vivant dans les zones à risque, et à la création de jardins filtrants et toitures végétalisées, la ville a réussi à réduire de 75 % les dégâts liés aux crues saisonnières depuis 2015.
Ces exemples africains démontrent que des solutions existent. Elles ne sont ni miraculeuses ni hors de portée. Elles demandent simplement une volonté politique claire, une coordination institutionnelle forte, une implication citoyenne réelle et une planification rigoureuse.
À la lumière de ces expériences et de ces exemples concrets, il est clair que Conakry peut sortir du cycle des inondations. Mais cela nécessite une approche sérieuse, structurée et ambitieuse. Voici sept mesures urgentes, précises et chiffrées qui peuvent changer la donne
Premièrement, la création d’au moins 10 bassins de rétention à ciel ouvert ou couverts dans les zones les plus inondables, (Entag, Sonfonia Gare, Bonfi, Dabompa, Wanindara, Kakimbo, Kissosso, Cosa, Taouyah, Matoto)\. Ces ouvrages, d’une capacité moyenne de 25 000 m³ chacun, permettraient de stocker temporairement les eaux pluviales et d’éviter leur débordement en zone habitée. Un budget estimatif de 5 millions USD par bassin, soit 50 millions, suffirait à leur réalisation, en partenariat avec les bailleurs internationaux.
Deuxièmement, le lancement d’un programme baptisé par exemple « Caniveaux pour la Vie » ou “Zéro Caniveau Bouché” piloté par le ministère des Travaux publics, avec l’objectif de curer, réhabiliter et couvrir 300 kilomètres de caniveaux d’ici 2028. Ce programme pourrait employer plus de 5 000 jeunes Guinéens, dans le cadre d’un chantier-école, avec un budget annuel de 25 millions USD sur 3 ans, financé par le Fonds d’Entretien Routier, dans la mesure où ces infrastructures sont liées à la viabilité des voiries.
Troisièmement, Lancement d’un programme national de gestion des déchets structuré autour de trois axes, d’abord, la construction de 5 centres de tri et de prétraitement, ensuite, la distribution de 500 000 poubelles domestiques dans les quartiers, enfin, l’instauration d’une redevance symbolique couplée à la facture d’électricité. Le tout pour un coût global de 30 millions USD, avec la participation active du secteur privé.
Quatrièmement, il faut une action vigoureuse contre l’occupations anarchique. Il devient impératif de décréter un moratoire immédiat sur toutes les constructions en zones inondables, avec un inventaire exhaustif des habitations à risque, accompagné d’un recensement et d’un plan progressif de relogement de 10 000 ménages sur cinq ans avec des logements sociaux construits en périphérie. Un fonds spécial de relogement et indemnisation des familles vulnérables, doté de 100 millions USD, pourrait être mobilisé sur cinq ans, en partenariat avec la Caisse de Prévoyance Sociale, les ONG humanitaires, cofinancé par les partenaires techniques et financiers. L’expérience ivoirienne montre que des solutions de relogement décent, associées à une politique foncière juste, sont possibles.
Cinquièmement, la mise en place d’un système moderne d’alerte précoce, avec des capteurs de niveau d’eau dans les principaux bassins, une ligne téléphonique d’urgence, et des messages d’alerte par SMS dans les quartiers à risque. Ce système, déjà testé au Ghana et au Cap-Vert, permet de sauver des vies en évacuant à temps.
Sixièmement, il serait également pertinent de créer un Fonds Souverain pour la Résilience Urbaine, doté d’une enveloppe initiale de 100 millions de dollars, alimenté par des contributions de l’État, et des partenaires techniques et financiers. Ce fonds permettrait de financer à la fois les projets d’infrastructures hydrauliques, la requalification des quartiers précaires et les innovations écologiques comme les “villes éponges”, concept déjà mis en œuvre dans plusieurs villes chinoises et qui consiste à multiplier les surfaces perméables, les jardins filtrants et les toitures végétalisées.
Enfin, l’intégration de l’éducation environnementale dans les programmes scolaires, de l’école primaire au lycée, ainsi que la valorisation du civisme urbain à travers les radios communautaires, les mosquées, les marchés et les groupes de jeunes. La population doit être pleinement impliquée dans cette transition, notamment par la valorisation des comportements écoresponsables. Une journée nationale du civisme climatique pourrait être instaurée pour rappeler que chaque sachet jeté dans un caniveau est une promesse de drame pour une famille.
Ces solutions ne sont pas des rêves. Elles ont déjà été mises en œuvre ailleurs. Elles sont finançables. Elles sont planifiables. Ce qui manque, c’est la décision politique, le courage administratif, et surtout le respect de la vie humaine.
Il est grand temps de sortir de l’indifférence et de la réaction. Les inondations à Conakry ne sont pas une fatalité. Elles sont le produit d’un abandon collectif, mais aussi le lieu d’une possible renaissance urbaine. L’eau ne doit plus tuer. Elle doit nourrir la terre, irriguer nos cultures et renforcer la vie. Le choix nous appartient, subir ou agir. Et face aux tombes creusées par les eaux, l’humanité nous commande de reconstruire, de prévenir, et d’aimer autrement notre capitale.
 Yakouba Mariame KONATE, Spécialiste en Partenariats Public-Privé, politique industrielle & Développement minier
Yakouba Mariame KONATE, Spécialiste en Partenariats Public-Privé, politique industrielle & Développement minierPar Yakouba Mariame KONATE
Doctorant en Administration des Affaires d’ESC–Clermont Business School
Spécialiste en Partenariats Public-Privé, politique industrielle & Développement minier
The post De l’urgence à la solution : des chiffres, des moyens, des vies… Voici comment prévenir les prochaines inondations à Conakry first appeared on Guineematin.com.
L’article De l’urgence à la solution : des chiffres, des moyens, des vies… Voici comment prévenir les prochaines inondations à Conakry est apparu en premier sur Guineematin.com.
.png)
 il y a 6 mois
374
il y a 6 mois
374















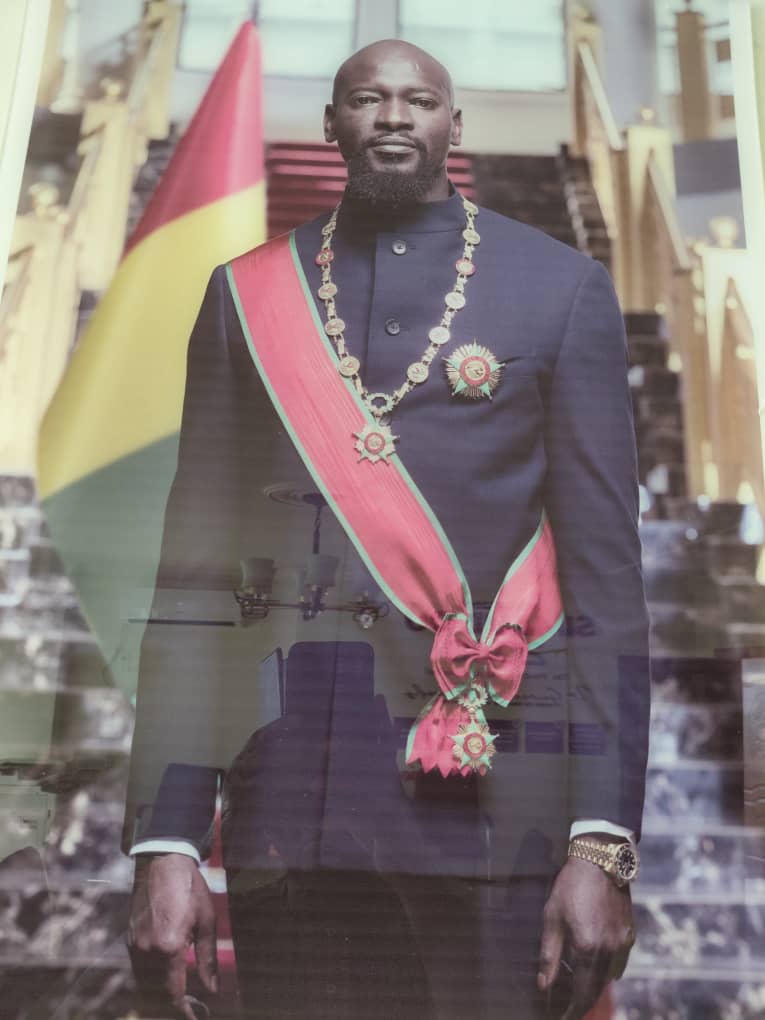

 English (US) ·
English (US) ·