PLACEZ VOS PRODUITS ICI
CONTACTEZ [email protected]

Connaitre tous les cours d’eau du monde et les poissons qui y habitent, est bien, mais cela est insuffisant. Savoir les noms des plantes et les maladies qu’elles guérissent, est aussi bien, mais cela ne suffit pas. Connaitre les chants des oiseaux et leurs interprétations est également bien, cependant, cela ne suffit pas. La meilleure des connaissances est la connaissance de soi.
La dot pour la mariée reste un aspect crucial dans toutes les traditions guinéennes. Son versement par le futur mari et sa famille à la future épouse est l’expression que le mari se doit de prendre en charge son épouse.
Dans le passé, rassembler la dot était une épreuve longue et difficile à la fois. Des familles pouvaient faire plusieurs années en train de la préparer.
Faisant partie des valeurs qui garantissent le mariage en Afrique, notamment en Guinée, la dot varie d’une communauté à une autre. Comme le dit Lisapo Ya Kama, dans « Les fondements du mariage en Afrique », Africain History ou Histoire Africaine : « La dot, ce n’est pas l’achat d’une femme par un homme comme l’ont imaginé ou caricaturé les Occidentaux, qui ont longuement véhiculé ce stéréotype. La dot, c’est tout simplement le pacte ou le gage qui scelle l’alliance entre l’homme et la femme (mariage) et l’union entre les familles dont les enfants se marient.
Le fait que la dot soit remise à la famille de la femme jusqu’à aujourd’hui encore est un vestige de la tradition matriarcale de l’Afrique. La dot est remise à la famille de la femme aussi en raison de la place et du rôle important que joue la femme dans le couple et dans la famille africaine. »
La dot est une compensation en biens que verse le futur marié à la famille de la future épouse. Ayant une portée traditionnelle et spirituelle, elle doit comporter : la dot proprement dite et le sadakou (ou salaire d’honneur qui est un emprunt à la tradition islamique). Elle doit être conforme à la coutume de la famille de la future épouse.
La dot proprement dite, se compose d’argent, d’un lot de nombreux cadeaux pour la femme, allant de pagnes (bazins riches, wax hollandais…) aux bijoux en or, en passant par des sacs, vaisselles, des chaussures…Ces cadeaux doivent être accompagnés d’une somme dont le montant varie selon les familles et les exigences des uns et des autres. Le montant n’est pas fixe, tandis que le « sadakou », c’est l’or (1 gramme) ou sa valeur. Certains, en fonction de leurs moyens, peuvent payer beaucoup plus.
En clair, la dot se négocie souvent entre les deux (2) familles pour parvenir à un accord. S’il y a des choses qui manquent à la dot, la famille du prétendant se retrouve aussitôt et envoie le complément. À défaut, elle s’engage à le faire après la célébration du mariage. Si certaines familles ne demandent pas grand-chose, d’autres par contre peuvent exiger des fortunes. Il faut préciser que jusqu’à présent, en milieu rural notamment, au sein de cette communauté, certaines familles demandent encore un animal (vache ou bœuf) comme une partie de la dot. C’est pourquoi le contenu de la dot peut varier d’une ethnie à une autre, d’un sous-groupe ethnique à un autre.
Il est important de préciser qu’avant, surtout dans les villages, avec certains sous-groupes linguistiques que sont les communautés kouranko (localisables entre les préfectures de Faranah, Kissidougou, Kankan et Kérouané) par exemple, la dot proprement dite c’étaient des bœufs dont le nombre varie d’une contrée, d’un milieu ou d’un individu, à un autre.
Dans la valise, outre les vêtements de la future mariée, ses bijoux et autres, se trouvent les boubous du père (avec une somme d’argent dans une des poches dudit boubou, somme appelée traditionnellement « dioufarô bila », de la mère (accompagné du prix de confection lorsqu’il n’est pas encore cousu), parfois, les présents sont élargis aux tantes et oncles de la mariée. Dans certaines familles, une somme d’argent est ajoutée à la valise ou malle dont le montant est fonction des moyens et capacités financiers du futur époux. Cette somme représente le prix de couture des différents boubous (habits) offerts aux parents.
La tradition doit certes s’enrichir des valeurs modernes pour perdurer, car aucune culture ne se suffit à elle seule. Toutefois, elle ne devrait pas être rejetée ou abandonnée au profit des valeurs venant d’autres cieux. D’ailleurs, un proverbe africain ne dit-il pas que : « Dormir sur la natte des autres, c’est comme si l’on dormait par terre » ?
Sayon MARA, Juriste
L’article La dot, pacte ou gage scellant l’alliance entre l’homme et la femme (mariage) et l’union entre deux familles [Par Sayon Mara] est apparu en premier sur Mediaguinee.com.
.png)
 il y a 9 mois
366
il y a 9 mois
366











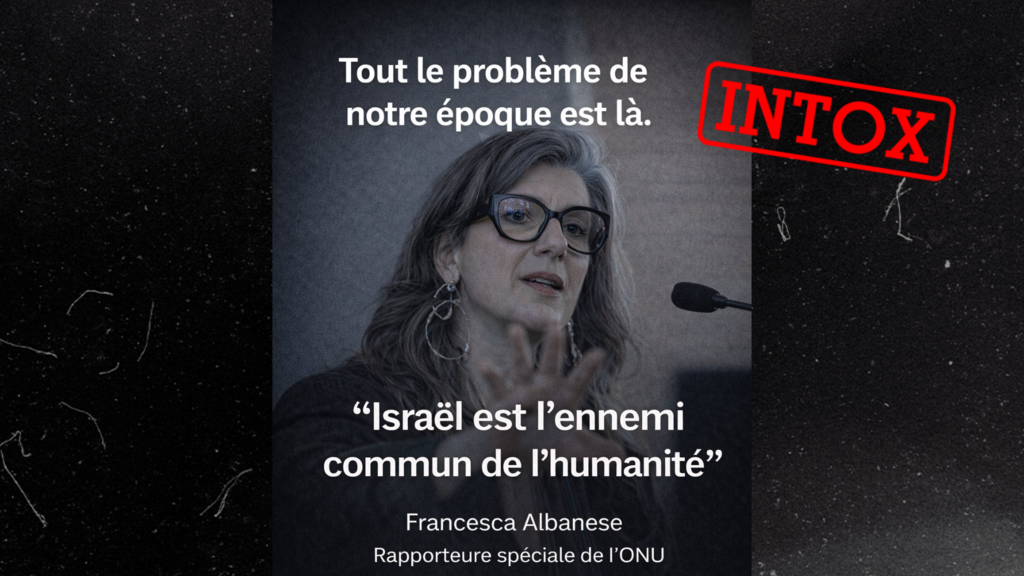






 English (US) ·
English (US) ·