PLACEZ VOS PRODUITS ICI
CONTACTEZ [email protected]

La localité de Yenga, village frontalier entre la Guinée et la Sierra Leone, est devenue au fil du temps le symbole d’un contentieux hérité de la colonisation. Ce différend, réactivé dans les années 1990 par les bouleversements géopolitiques et les conflits armés dans la sous-région, oppose deux États autour d’un territoire revendiqué, pourtant habité par une même communauté ethnique, les Kissis.
Dans cet entretien grand format, le Dr Faya Moïse Sandouno, historien et spécialiste reconnu des questions frontalières, retrace l’histoire de cette crise, en s’appuyant sur les accords coloniaux tels que la convention franco-britannique de 1912, souvent imposés sans consultation locale. Il revient également sur les conséquences des guerres civiles en Sierra Leone et au Libéria, qui ont favorisé l’intervention militaire guinéenne à Yenga dans les années 2000, sur fond d’enjeux sécuritaires, mais aussi économiques, notamment liés à la présence de diamants.
Dr Sandouno analyse enfin les résultats des missions techniques, comme celle de 1987, qui ont localisé les bornes 15 et 16 à 800 mètres du fleuve Makona, élément clé dans la revendication guinéenne, affirmant que « Yenga selon les textes, appartient à la Guinée. Lisez !
‘’En 1974, il y a eu les premiers remous sur la paternité de cet espace frontalier qu’on appelle Yenga. La Guinée a estimé que le territoire lui appartient, la Sierra Leone a tenu le même discours. Alors la question est montée au niveau du sommet des deux États, et les deux Chefs d’État d’alors, Siaka Stevens de la Sierra Leone et Ahmed Sékou Touré de Guinée, ont engagé des négociations diplomatiques qui ont permis de régler ce problème à l’amiable’’
Mediaguinee.com : Que retenir de façon générale sur les origines de ce différend frontalier entre la Guinée et la Sierra Leone autour de la localité de Yenga ?
Dr Moïse Sandouno : La question des frontières entre la Guinée et la Sierra Leone, notamment au niveau de la zone de la localité frontalière appelée Yenga, un petit village de quelques maisons, fait l’objet de polémiques et de disputes depuis plusieurs années déjà entre ces deux (2) pays. Mais pour bien camper cette situation, il faut faire un recul en interrogeant même la genèse de ce conflit frontalier. Alors, on est dans la phase coloniale, et donc pour réglementer l’occupation des frontières, il a été convoqué la conférence de Berlin, en 1884, laquelle conférence a institué un nouveau principe, celui de l’occupation effective. Et partant sur la base de ce principe, la France et la Grande-Bretagne (Angleterre), qui étaient déjà dans la localité, ont voulu matérialiser leur frontière, en fixant la limite de leurs différentes positions territoriales. C’est ce qui a fait qu’il y a eu plusieurs conventions entre les colonies de ces deux pays. Et parmi ces conventions, il y a l’accord franco-britannique de 1912, qui délimite donc la zone en question, qui est l’objet de ce présent conflit au niveau du fleuve Makona. Alors, en 1974, il y a eu les premiers remous sur la paternité de cet espace frontalier qu’on appelle Yenga. La Guinée a estimé que le territoire lui appartient, la Sierra Leone a tenu le même discours. Alors la question est montée au niveau du sommet des deux États, et les deux Chefs d’État d’alors, Siaka Stevens de la Sierra Leone et Ahmed Sékou Touré de Guinée, ont engagé des négociations diplomatiques qui ont permis de régler ce problème à l’amiable, sur la base de cet accord franco-britannique. Et depuis 1974, le problème n’a pas fait l’objet de polémiques entre les deux pays.
Mediaguinee.com : Que savez-vous de l’origine de la fondation du village de Yenga ? Et selon vous, l’histoire de sa création permet-elle de conforter la position guinéenne dans ce litige ?
Dr Moïse Sandouno : Lors de mes recherches de terrain, j’ai interviewé une des personnes ressources de la localité, un doyen Kissien me faisait savoir, en l’interrogeant sur la genèse même de ce village, que cette localité aurait été créée par un monsieur qui s’appellerait Fara Yènkô Ouéndéno, qui venait de Ouéndé Kénéma, une des sous-préfectures de la Guinée. Et pour ce doyen-là, ce village Yenga appartient à notre pays. Ce témoignage a alors conforté un peu les missions techniques qui avaient été sur le terrain, et qui a réussi à identifier les bornes 15 et 16, telles que mentionnées dans l’accord franco-britannique de 1912. Aujourd’hui la situation est pressante, et depuis les deux derniers mois, il y a eu une montée de tensions encore entre les armées des deux pays. Finalement, les populations du village de Yenga ont été obligées de quitter le village pour qu’éventuellement, elles soient mises à l’abri de tout ce qui pourrait advenir comme violence. Figurez-vous d’ailleurs que la localité en question est habitée par les mêmes communautés, par le même groupe ethnique, que sont donc les Kissis, qui sont à cheval entre la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée.
‘’ (…) La frontière n’est pas le fleuve Makona, qui dans l’imaginaire sierra-léonais constitue la limite ou la frontière naturelle, mais plutôt les deux bornes qui se situent après le village de Yenga. C’est ce qui a fait que, dans ce contexte de guerre, l’armée guinéenne est venue mettre une base militaire juste à la sortie de ce village de Yenga, qui correspond aux 800 mètres mentionnés dans ce rapport de reconnaissance’’
Et dans le contexte de la guerre, c’est-à-dire les attaques rebelles aux frontières, donc la guerre civile qui a commencé au Libéria et qui a eu ses ramifications en Sierra Leone, et par la suite, la Guinée a été aussi victime de plusieurs attaques rebelles au niveau de ses zones frontalières, dont les préfectures les plus touchées sont Macenta, Guéckédou et certaines parties de Faranah et de Forécariah. Alors, pour le cas spécifique de Guéckédou, la zone de Yenga a été l’une des portes d’entrée, parce que cette localité est de l’autre côté du fleuve. Et dans l’accord diplomatique préalablement cité, il est prévu à l’article 8 notamment, que le fleuve et les îles appartiennent en entier à la France, donc à la partie guinéenne, mais que les deux populations riveraines ont les mêmes droits d’exploitation de ce fleuve. Voyez-vous déjà qu’il y a matière à s’interroger. On ne peut pas dire que ce téléphone appartient à X et dire en même temps que monsieur Y a les mêmes droits d’exploitation de ce téléphone.
Parlant des années où il y a eu des attaques rebelles perpétrées sur le territoire guinéen, la Guinée a essayé de constituer une lutte défensive. C’est ce qui a poussé la Guinée à essayer de regarder non seulement au niveau de ces accords diplomatiques, mais aussi des cartes d’État-major.
Mediaguinee.com : Vous avez tantôt rappelé la question des bornes. Dites-nous à quel point les repères historiques, issus de la convention notamment de 1912, renforcent-ils juridiquement la revendication guinéenne par rapport à la perception sierra-léonaise d’une frontière naturelle basée sur le fleuve Makona ?
Dr Moïse Sandouno : Après une mission technique qui s’est rendue sur les lieux en 1987 pour faire la reconnaissance des limites frontalières, il est mentionné quelque part dans la convention de 1912 que les bornes 15 et 16, qui se trouvent à 800 mètres du fleuve Makona sur la rive droite, donc du côté sierra-léonais, ont été identifiées grâce à cette mission. Au regard donc de cette mission et du rapport technique qui a été élaboré par une équipe guinéenne, ils se sont rendu compte qu’effectivement, la frontière n’est pas le fleuve Makona, qui dans l’imaginaire sierra-léonais constitue la limite ou la frontière naturelle, mais plutôt les deux bornes qui se situent après le village de Yenga. C’est ce qui a fait que, dans ce contexte de guerre, l’armée guinéenne est venue mettre une base militaire juste à la sortie de ce village de Yenga, qui correspond aux 800 mètres mentionnés dans ce rapport de reconnaissance. Alors, quand les hostilités se sont calmées, la Sierra Leone a estimé que la Guinée avait fait une occupation de son territoire, donc il y a eu pas mal de pourparlers entre les deux États. Finalement, il y a eu en 2012 un accord de retrait des forces armées, donc la Guinée a opéré le retrait, mais la zone est restée toujours sous le contrôle de l’armée guinéenne parce qu’au regard des textes, des accords diplomatiques qui sont là, mais aussi du travail de cette mission technique de 1987, cette zone-là appartiendrait à la Guinée, puisqu’il faut manifestement que les deux États poursuivent les négociations au niveau diplomatique, en impliquant bien entendu les parties techniques, pour voir comment régler définitivement ce problème de conflit qui est beaucoup plus politique, parce que les communautés riveraines, les Kissi qui sont de part et d’autre du fleuve, c’est la même communauté, ce sont des frères, ce sont des cousins, il y a des alliances, des mariages et ainsi de suite.
‘’Ce sont les deux puissances coloniales, la France et la Grande-Bretagne, en 1912, qui ont élaboré cet accord diplomatique-là qui délimite ces espaces-là. Et donc, au regard de cet accord diplomatique, la zone appartient à la Guinée’’
Mediaguinee.com : A quel niveau se situe de nos jours la responsabilité des institutions face à ce conflit ?
Dr Moïse Sandouno : Aujourd’hui la question est vraiment préoccupante, pour non seulement les partenaires techniques et financiers, tels que la GIZ, mais aussi l’Union Africaine, qui a d’ailleurs un programme qui repose justement sur la réglementation, la gouvernance des espaces frontaliers. Et il y a, au mois de juin passé, eu une réunion des quatre États membres de l’Union du fleuve Makona, à Monrovia, au Liberia, qui avait pour objectif justement de mettre en place des commissions mixtes frontalières, puis procéder éventuellement à la réaffirmation des accords de délimitation, mais également procéder à la délimitation et à la démarcation de ces zones frontalières, puisque le problème aussi est qu’à plusieurs endroits, ces zones frontalières-là ne sont pas véritablement démarquées. Il n’y a pas de repères, et donc pas de bornes qui puissent dire à tel endroit se situe effectivement la limite. Au-delà des institutions, c’est une question qui interpelle nos autorités, parce que c’est une question de souveraineté. Il y a bien entendu des initiatives de médiation et de résolution de ces conflits au niveau local, mais lorsqu’il s’agit d’une question de souveraineté, parce qu’une frontière, c’est la limite du territoire d’un État, et dès qu’on parle d’État, on a forcément la présence des autorités qui doivent, au niveau le plus élevé de l’État, engager ces négociations-là pour que le problème soit résolu de manière pérenne et éviter qu’à chaque fois, comme il y a eu résurgence d’ailleurs à partir des années 2000, cela ne fasse plus l’objet d’une telle situation. Que les deux États, sur la base de négociations en impliquant les parties techniques, parviennent à un accord définitif pour que la paix règne dans cette localité qui, comme je le disais d’ailleurs, est habitée par la même communauté ethnique qui a des liens de parenté, de mariage, de cousinage, ainsi de suite. C’est une question est éminemment politique et elle ne peut être résolue que sur le plan politique, sur le plan diplomatique. Mais avec la volonté des chefs d’État, on peut arriver à trouver véritablement une issue pérenne à ce conflit. Et je peux vous dire que ces initiatives sont en cours depuis plusieurs années déjà, mais comme vous le savez, les questions de souveraineté sont souvent très délicates, parce que chaque partie souhaiterait que le drap soit tiré de son côté. Et lorsqu’il y a des enjeux, la zone est réputée être une zone riche en diamants. Et c’est pourquoi je rouvre d’ailleurs cette parenthèse dans le contexte de ces attaques rebelles-là. Le RUF (Revolutionary United Front), qui était l’entreprise de guerre de Foday Sankhon, qui a perpétré les attaques rebelles au niveau des frontières guinéennes, a commencé à exploiter le diamant dans cette zone-là. Et ce diamant-là permettait justement d’alimenter, de faire fonctionner, de faire bien tourner son entreprise de guerre et venir attaquer la Guinée. Voilà aussi une des raisons pour lesquelles la partie guinéenne s’est dit « Écoutez, on ne peut pas venir exploiter les ressources sur un territoire qui est réputé être le nôtre et utiliser ces moyens-là pour venir nous attaquer ». Donc, c’est là que cette base militaire a été mise en place, voyez-vous.
‘’Moi, je parle sur la base des textes‘’
Mediaguinee.com : Lors d’une rencontre à Nongoa, l’ancien ministre de l’Administration du Territoire, feu Moussa Solano, avait rapporté que son homologue sierra-léonais avait reconnu l’appartenance de Yenga à la Guinée. Il affirmait même que notre pays ne doit jamais renoncer à ce territoire. Partagez-vous cette position ?
Dr Moïse Sandouno : moi, je parle sur la base des textes, parce qu’il y a des conventions diplomatiques avant même que la Guinée ne soit État indépendant ou que la Sierra Leone ne soit également. Ces deux territoires appartenaient alors à deux colonies différentes : la Guinée à la partie française, et la Sierra Leone à la Grande-Bretagne. Et ce sont ces deux puissances coloniales-là, en 1912, qui ont élaboré cet accord diplomatique-là qui délimite ces espaces-là. Et donc, au regard de cet accord diplomatique, la zone appartient à la Guinée. Je vous ai parlé des bornes 15 et 16 qui ont été identifiées à 800 mètres au-delà du fleuve, donc sur la rive droite. Et le village dont on parle est avant les 800 mètres. Donc, sur la base de ces textes-là et sur la base d’un ensemble de missions de reconnaissance de terrain effectuées dans la localité, il a été établi que ce territoire-là appartient à la Guinée. Il y a une réalité et c’est une situation de fait. C’est vrai que la Guinée ou les populations guinéennes n’ont jamais habité cette zone-là. Les Kissiens qui ont habité cette zone jusque-là se réclamaient du côté sierra-léonais. Est-ce que par ignorance ou est-ce que par volonté de se rattacher peut-être au territoire sierra-léonais ? Mais sur la base des textes qui existent, cette partie-là relève du territoire guinéen. Donc, je peux confirmer, comme vous avez posé cette question.
Mediaguinee.com : Comment expliquer que les populations qui vivent à Yenga se réclament massivement de la Sierra Leone ? Selon vous, cette distance entre la légalité territoriale et le sentiment d’appartenance local ne compliquent-ils pas davantage la résolution du litige ?
Dr Moïse Sandouno : Ça, c’est un constat qui est généralement fait au niveau des zones frontalières. Ce n’est pas seulement au niveau de la zone de Yenga. Vous voyez, lorsqu’une situation de ce genre arrive, les populations qui sont dans la localité n’ont pas un attachement effectif avec leur État d’appartenance et d’origine. Ces populations vont se sentir beaucoup plus attachées à l’État qui, disons-le, estime que ces populations-là relèvent de son territoire ou de son territoire national. Et ça peut être le cas de ces populations-là. Comme je le disais, depuis les indépendances, ce territoire-là a été occupé par des Kissiens mais qui se réclament du côté de la Sierra Leone.
Mediaguinee.com : La situation de Yenga pourrait-elle, selon vous, se reproduire à d’autres points frontaliers de la Guinée, comme avec la Côte d’Ivoire ?
Dr Moïse Sandouno : C’est un autre cas de figure aussi, la frontière entre la Guinée et la Côte d’Ivoire au niveau de la localité de N’Zoo, les villages de Gbéyaba. Et d’ailleurs, l’information que je peux partager avec vous, c’est qu’il y a juste une semaine, après la rencontre de Monrovia qui a permis de mettre en place les commissions mixtes frontières, la Guinée et la Côte d’Ivoire ont signé leur accord de délimitation. Donc je crois que, sur la base de tout ce qui a été fait par le passé, notamment la dernière rencontre de Monrovia, ça a permis aux deux États de prendre la mesure de la chose et finalement d’aboutir à la signature de cette convention de délimitation entre la Guinée et la Côte d’Ivoire. C’est un peu ce même scénario qu’on pourrait envisager pour les autres zones frontalières, et c’est d’ailleurs là l’un des objectifs du programme africain de l’Union africaine, pour justement faire en sorte que les espaces frontaliers fassent l’objet d’une gestion harmonieuse de coopérations, que ça devienne beaucoup plus des zones de coopérations transfrontalières que des zones de tensions. Et l’exemple de la Guinée et de la Côte d’Ivoire peut justement servir pour faire en sorte aussi que le cas avec la Sierra Leone puisse être réglé définitivement.
Mediaguinee.com : Avez-vous une expérience à partager avec nos lecteurs sur ces conflits frontaliers, aussi bien qu’en Guinée qu’ailleurs ?
Dr Moïse Sandouno : Je me suis toujours intéressé à la question des frontières depuis que j’avais le niveau Master. C’est un sujet qui est extrêmement passionnant, même s’il est très complexe aussi. Parce que, imaginez, lorsqu’il faut faire des recherches sur des frontières, des limites qui ont été tracées entre les années 1800 et 1958, pour le cas de la Guinée, figurez-vous déjà que ça fait beaucoup d’années de recherche et il faut faire une grande triangulation de recherche d’informations. Au-delà de la Guinée, j’ai pu faire des voyages. D’ailleurs, j’ai fait ma thèse de doctorat en France. Ça m’a permis de visiter aussi les archives nationales d’outre-mer, en Provence, à Marseille.
Et donc ça m’a permis d’avoir une documentation bien fournie. Ce qui fait qu’aujourd’hui, la plupart des conventions diplomatiques, des actes administratifs concernant la délimitation des frontières guinéennes, je les ai. Et c’est ce qui m’a d’ailleurs permis de véritablement avoir des connaissances bien approfondies là-dessus, sur cette question-là.
Et vous voyez, ce livre-là, il vient d’être publié aux éditions L’Harmattan, La République de Guinée et ses frontières, années 1880-2010, héritage colonial, négociation et conflictualité. Et dans ce livre-là, j’ai abordé la question de toutes les frontières guinéennes, partant des accords au plan diplomatique, au plan administratif, avant leur matérialisation sur le terrain, avant leur délimitation. Et ensuite, dans l’ouvrage, vous trouverez une autre dimension qui est très intéressante. C’est qu’à partir des années 1970, on voit germer les premiers conflits autour de ces frontières-là. Et ces conflits, d’ailleurs, ont fait l’objet de beaucoup de mécanismes de résolution, que ce soit au plan local ou au niveau du sommet des différents États. Et donc, vous avez tous ces éléments-là dans cet ouvrage. Et donc, cette expérience-là, je peux la partager déjà à l’université. Je suis enseignant-chercheur, maître de conférences des universités. Et j’ai un cours à l’université que je donne sur ces questions des frontières-là. Alors à chaque fois que mon expertise est sollicitée sur la question, je me prête disponible.
Mediaguinee.com : Quel message adressez-vous aux autorités politiques guinéennes pour sortir durablement de cette impasse frontalière ?
C’est de les encourager à poursuivre cette dynamique qui est déjà en cours avec l’appui des partenaires internationaux, de l’Union Africaine, de la GIZ. Parce que, comme je le disais, la question des frontières relève de la souveraineté des États. Les populations locales ne peuvent pas délimiter les frontières, ne peuvent pas démarquer les frontières. Les communautés qui sont concernées par ces tensions frontalières-là, c’est vrai qu’il peut y avoir des mécanismes endogènes, des mécanismes traditionnels de résolution de tensions, de conflits au niveau local. Mais pour régler durablement ces questions-là, il faut que ça soit au niveau du sommet des États. Et je n’ai d’autre point que la volonté des États en question, de la Guinée et des États voisins, à engager cette dynamique-là pour faire en sorte que ces questions soient résolues de manière définitive. Et je sais que, dans un passé récent, les deux chefs d’État se sont retrouvés dans la localité, le président guinéen et le président léonais. Et je crois que c’est une dynamique qui est là déjà. C’est une volonté réelle d’aller de l’avant et de faire en sorte que la question puisse être réglée définitivement. Et je ne doute point que, dans les jours à venir ou les mois à venir, cette initiative-là puisse se poursuivre pour permettre justement de régler ce problème.
Entretien réalisé par Sâa Robert Koundouno et Ousmane Camara
L’article Interview- Dr Faya Moïse Sandouno : ‘’la zone de Yenga appartient à la Guinée…’’ est apparu en premier sur Mediaguinee.com.
.png)
 il y a 6 mois
234
il y a 6 mois
234






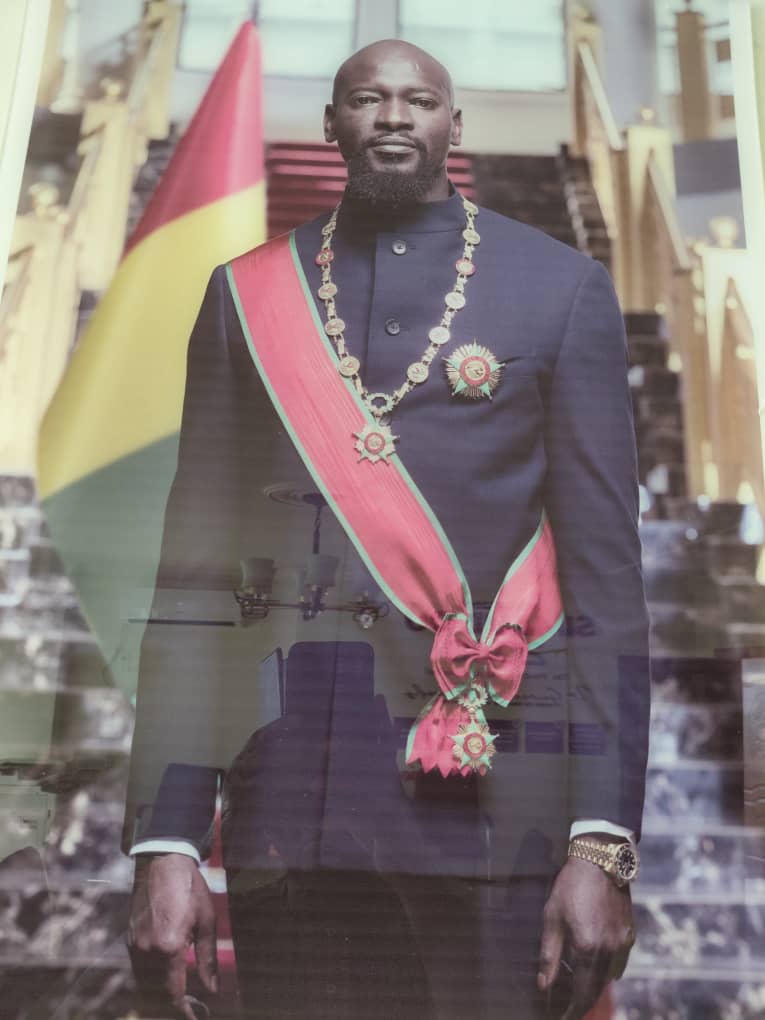










 English (US) ·
English (US) ·